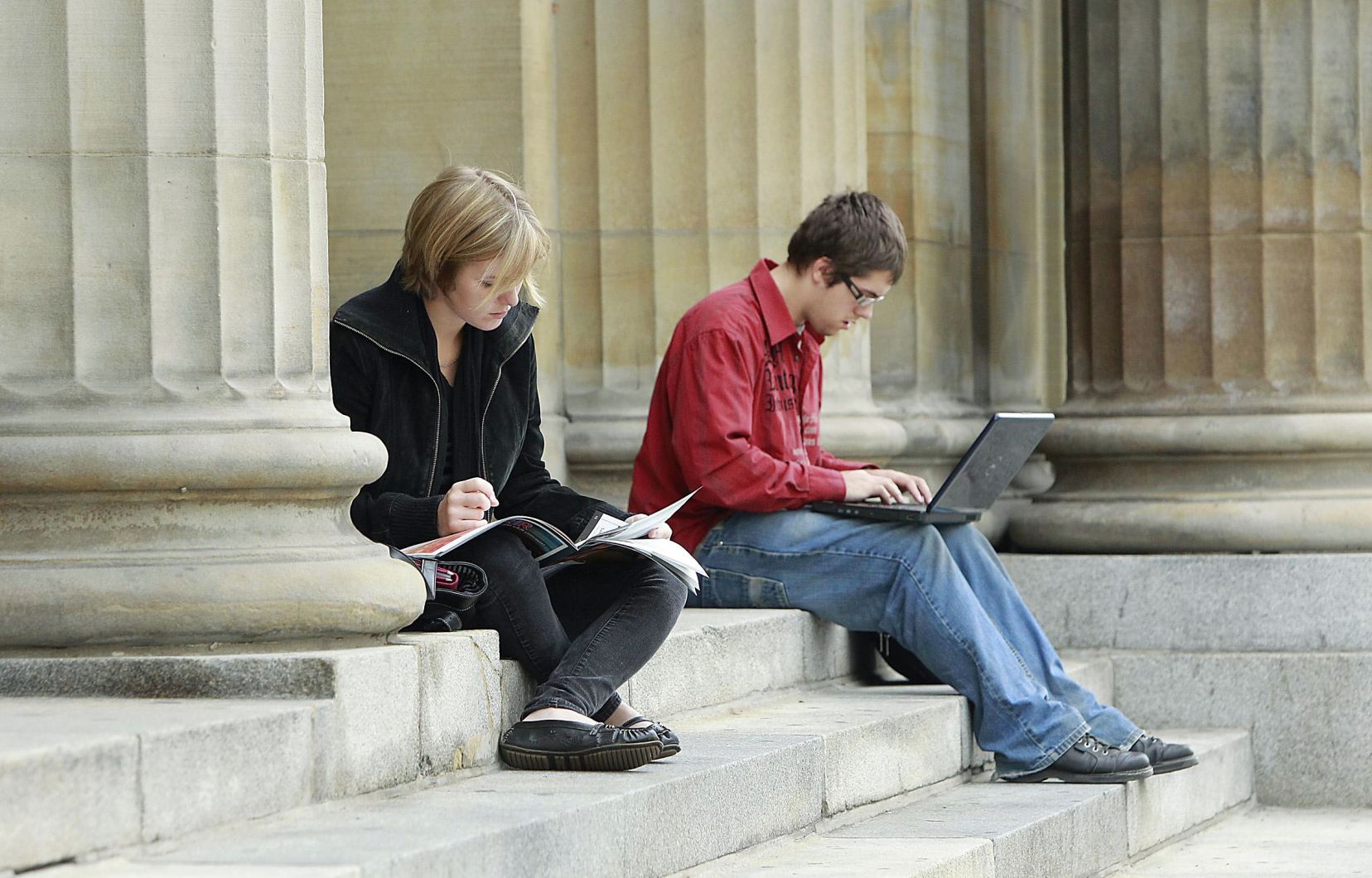Il faudrait peut-être décoller son nez de ses stories Instagram, de ses « engagements » dans les réseaux sociaux numériques, des big dataqui nous façonnent et des égoportraits qui nous affligent pour en prendre un peu plus conscience : « L’incessante poursuite de nouvelles connaissances, de découvertes et fabrications innovantes, l’accumulation infinie de données, leur numérisation, leur diffusion universelle modifient la pensée, qui modifie le langage, nécessairement contaminé par la pensée et la langue technique en général, numérique en particulier », écrit Jean-Michel Delacomptée dans Notre langue française, une exploration politique et esthétique de la langue sur un terrain balisé par l’inquiétude, la lucidité et l’érudition.

Comme tout organisme vivant — et surtout vibrant —, le français a été, est et sera toujours en mutation. Mais par les temps qui courent, il serait bon de puiser dans la richesse de cette langue pour trouver les mots justes, ceux exprimant la méfiance, estime l’écrivain et essayiste prolifique qui nomme, lui, les écueils du moment. « Nous gagnons en précision ce que nous perdons en imagination. » Et pour le gardien des territoires imaginaires, il n’y a pas de quoi se réjouir.
Ses craintes sont partagées par le journaliste Philippe Meyer. Dans un texte intitulé « Les mots pour le vivre », qui fait partie de l’ouvrage collectifLe Français a-t-il perdu sa langue ?, il se désole en effet du harcèlement très contemporain des communiquants, « dont le métier est de falsifier les mots. En les vidant de leur substance par une répétition psalmodique et un usage clérical ». Des attaques sournoises, un « nivellement par le médiocre », dit Delacomptée, dont les gourous de la Silicon Valley ne sont pas les seuls responsables.

Les ténors de la standardisation et de l’homogénéisation ambiante seraient également ailleurs. « Citoyen, solidaire, participatif, moderne, ne sont plus des adjectifs mais des bruits, des signaux sonores indiquant que l’on pénètre dans un territoire sacré où il serait […] blasphématoire de demander à un orateur de rendre compte du sens de ses phrases et des rapports entre ses mots et la réalité », écrit Meyer, en ajoutant : « Nous sommes des fanfarons d’individualisme qu’une pluie de prescriptions, décrétées par […] des académies invisibles, suffit à faire entrer dans le rang. Une petite pluie. À peine pistouillante. Mais tenace. » Joli.
Pas moraliste, mais « écrivain laborieux » qui « creuse les mots pour en tirer un fruit mangeable », Jean-Michel Delacomptée ne se pose pas non plus en passéiste se désolant face au progrès.
Plutôt, il éclaire le caractère pernicieux d’une « novlangue » qui « suce la mentalité » de la langue « avec une boulimie voilée » et qui porte atteinte ainsi à son caractère équivoque, à ce « noyau de valeurs intellectuelles et morales élaborées par les générations passées » et qui maintient la « ligne de démarcation entre une société vivable et un monde post-humain », écrit-il.
La langue est patrie, disait Gaston Miron. Elle est aussi héritage et résistance par « la littérature », souligne l’essayiste, littérature à laquelle reviendrait aujourd’hui « la tâche de freiner l’abstraction technicienne en voie d’implantation dans nos cervelles ». « Non pas la littérature amincie et déjà mécanique qui tapisse les têtes de gondole, ajoute l’essayiste, mais les oeuvres qui brassent large et creusent profond. »
L’écrivain et cinéaste Atiq Rahimi, dans l’essai collectif sur l’état du français, auquel participent aussi Nancy Huston, Alice Zeniter, Michaëlle Jean, Alain Rey, Kamel Daoud…, en rajoute, en circonscrivant le texte littéraire comme une syntaxe donnée au cri et à un acte de profération, pour paraphraser Gilles Deleuze. « Et même si ce cri n’éveille pas les esprits endormis au moins il perturbe leur sommeil ! » écrit-il confirmant ainsi qu’une langue qui se menace dans son évolution est aussi capable de se défendre elle-même.