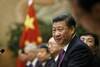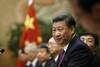Un vent de fraîcheur a soufflé, mais il est bel et bien en train de tomber. Deux ans et demi après son élection, et l’espoir d’une politique étrangère renouvelée au lendemain de la décennie sombre et brutale de l’ère Harper, Justin Trudeau est encore loin du point de rupture annoncé en campagne électorale, estime le chercheur et spécialiste des questions internationales Jocelyn Coulon en évoquant les hésitations et les nombreuses erreurs du premier ministre, dont la dernière en date tient dans l’image persistante d’une famille déguisée en sikh devant le Temple d’or à Amritsar, au Pendjab, lors d’un voyage officiel en Inde.
Pis, « sur plusieurs aspects de son programme […], les décisions s’éloignent à ce point des intentions originelles [sur le maintien de la paix, l’aide au développement, les relations avec la Russie, l’attitude dans le conflit israélo-palestinien ou le réengagement en Afrique] que le résultat » s’inscrit « dans la continuité de l’ancien gouvernement conservateur » plutôt que dans une vision neuve de la place du Canada dans le monde. Un vide qui risque d’ailleurs de coûter au pays le siège au Conseil de sécurité de l’ONU que convoite le gouvernement de Justin Trudeau pour 2020 afin d’actualiser son slogan « Le Canada est de retour », indique Jocelyn Coulon dans Un selfie avec Justin Trudeau (Québec Amérique), essai percutant sur une diplomatie canadienne qui, à trop chercher l’image, finit par oublier les idées.
« Indéniablement, on a bien accueilli l’arrivée de Trudeau au pouvoir un peu partout dans le monde », écrit Jocelyn Coulon, qui a été acteur et témoin de l’élaboration et de la mise en oeuvre de la politique étrangère du premier ministre, d’abord au Conseil consultatif du candidat Trudeau, en 2014-2015, puis comme conseiller du ministre des Affaires étrangères Stéphane Dion de 2015 au début de 2017. « Là où il passe, il laisse une impression de dynamisme, d’ouverture et d’écoute. Sa rhétorique sur la diversité, la tolérance, l’accueil représente une véritable bouffée d’air frais à une époque où les discours de haine et de xénophobie ébranlent les sociétés et favorisent l’émergence de forces populistes. »
« Mais dans les rencontres à huis clos, à l’ONU, à l’OTAN, les gens doivent se demander ce que le Canada a désormais à mettre sur la table », poursuit le chercheur et commentateur de l’actualité internationale dans une entrevue accordée mercredi au Devoir. « Parce que, pour le moment, le retour du Canada sur la scène internationale tient bien plus du slogan que de l’action. »
Témoignage de l’intérieur, l’essai se veut aussi le « témoignage d’une déception » face à un premier ministre qui, dit Jocelyn Coulon, « ne comprend pas le monde réel », ce qui en fait un leader « indécis et désorienté » sur la plupart des grands dossiers. « Il cède aux groupes de pression, au détriment de l’intérêt national qui demande de développer une vision stratégique afin d’agir à long terme, écrit-il. Les sondages et les médias exercent sur lui plus d’influence que les avis des ambassadeurs et diplomates. » Et ce manque de repère, ces incertitudes sont devenus un frein évident à l’écriture d’une politique internationale permettant au Canada de renouer avec l’Afrique, avec la Russie, de contribuer au développement du reste du monde et d’y maintenir la paix.
« Le Canada va devoir convaincre 128 des 192 États membres de l’ONU pour décrocher un des deux sièges qui vont se libérer au Conseil de sécurité, explique Jocelyn Coulon. Sans aller chercher les 54 pays d’Afrique, le plus gros bloc politique au monde, il n’y arrivera pas », laissant ainsi la voie libre à la Norvège et à l’Irlande, également dans la course. « Or, l’empreinte diplomatique du Canada sur ce continent est en train de s’effacer et rien n’est fait pour renverser cette tendance. »
Le chercheur note entre autres dans son essai que le Canada compte aujourd’hui 21 représentations diplomatiques sur le continent, soit 19 de moins que la Turquie et une de moins que la Corée du Sud, « un pays qui ne parle ni anglais, ni français », mais qui, autant que la Norvège, consacre plus de 0,7 % de son revenu national brut à l’aide publique au développement, soit la recommandation faite par Lester B. Pearson dans les années 1970 et que Justin Trudeau, en campagne électorale, s’était engagé à atteindre. Or, cette aide canadienne est de 0,27 %, après avoir été de 0,32 % sous le gouvernement Harper.
« Les politiciens canadiens doivent aller à la rencontre des Africains s’ils souhaitent que le Canada soit pris au sérieux, écrit-il. Or, en 2016, Justin Trudeau décline une invitation à prononcer un discours lors du sommet des chefs d’État de l’Union africaine de Kigali, au Rwanda ». Une erreur étonnante à la lumière des nombreux conseils et documents préparés à son attention pour lui rappeler l’importance de l’Afrique, « une des clés du retour du Canada sur la scène internationale », rappelle Jocelyn Coulon.
Les relations avec la Russie tombent dans le même vide, souligne l’expert qui, tout en évaluant la difficulté inhérente à la chose, juge ce rapprochement plus que nécessaire. « La Russie occupe 75 % de l’Arctique avec le Canada. Cette région, c’est la prochaine frontière écologique, économique, militaire », qui semble être regardée de loin par un gouvernement trop préoccupé en ce moment par les relations avec le voisin américain, Donald Trump, et ses humeurs changeantes. Or, ce dialogue, de par l’interconnexion entre les deux pays, relève plus de la politique intérieure que d’une politique étrangère qui, elle, pendant ce temps, attend que l’on s’occupe un peu plus sérieusement d’elle.
[...]