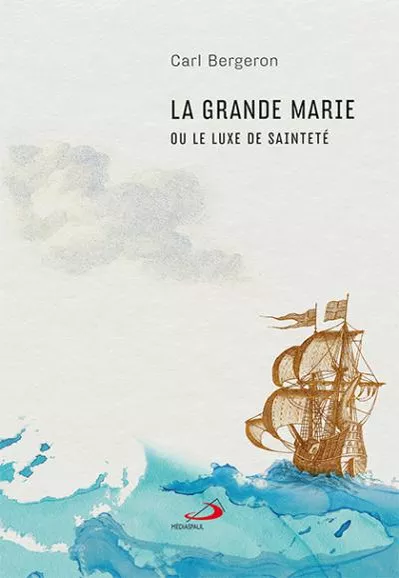FIGAROVOX/GRAND ENTRETIEN - Dans son nouvel ouvrage, l'écrivain Carl Bergeron retrace la vie de Marie de l'Incarnation. Epistolière remarquable, cette missionnaire française du Grand Siècle est une figure fondatrice du Québec qui mérite d'être redécouverte, explique-t-il.
Carl Bergeron est écrivain. Né au Québec en 1980, il est l'auteur de deux ouvrages remarqués, Un cynique chez les lyriques -Denys Arcand et le Québec (Boréal, 2012) et Voir le monde avec un chapeau (Boréal, 2016). Son nouveau livre, La grande Marie ou le luxe de sainteté (Médiaspaul, 80 p., 19.95$), paraît ces jours-ci au Québec et sera diffusé en France en août.
FIGAROVOX. - Pourquoi avoir choisi de raconter la vie de Marie de l'Incarnation et son œuvre à la fois missionnaire, spirituelle et littéraire ? Pourriez-vous la présenter au lecteur ?
Carl BERGERON. - Sainte Marie de l'Incarnation – ou Marie Guyart – est née à Tours en 1599 et est morte en 1672 à Québec. Elle est issue de la Réforme catholique. Béatifiée par Jean-Paul II en 1980, elle a été canonisée par François en 2014. Avec les Samuel de Champlain, Jean de Brébeuf et François de Montmorency-Laval, elle fait partie des grandes figures fondatrices de la Nouvelle-France. Les Français l'ont naturellement oublié (l'historien Gilles Havard a parlé «d'Amérique fantôme»), mais il fut un temps où l'Amérique, de la mer du Nord (baie d'Hudson) à la Louisiane, des côtes de Terre-Neuve au pays de l'Ohio, était française. C'est dans cet espace traversé de cours d'eau et d'une «forêt infinie», selon l'incipit des Relations des jésuites, que se déploient les explorateurs et les missionnaires de l'époque.
350 ans après, dans une librairie du Plateau Mont-Royal, à Montréal, je suis tombé par hasard sur l'édition de la Correspondance par l'abbaye de Solesmes. Je me suis engagé dans ma lecture, et en suis ressorti quelques mois plus tard, totalement sous le charme de la grande mystique et transformé par ma rencontre. Car pareille lecture «longue», qui ne relève pas de l'expérience courante, procède à bien des égards de l'ascèse, de la rencontre, de la communion. On ne lit pas la Correspondance comme on lirait le dernier roman à la mode. Elle n'exige pas le même état d'esprit ni, cela va de soi, le même effort.
Vous parlez de Marie de l'Incarnation comme d'une figure qui pourrait agir à la manière d'un pont entre la France et le Québec. Pouvez-vous nous expliquer en quoi ?
Ce n'est pas que Marie de l'Incarnation, mais la Nouvelle-France tout entière qui doit devenir un pont entre nos deux peuples, qui ne sont pas «cousins», comme on le dit trop souvent, mais bel et bien frères. La porte d'entrée de l'Amérique pour la France, la porte mythique, j'entends, et non la porte commerciale, n'est pas la Hudson River mais le fleuve Saint-Laurent. La Guerre de Sept Ans (1756-1763) («première guerre mondiale», selon le mot de Winston Churchill) a marqué le début de la «provincialisation» de la France, qui se voit privée par le Traité de Paris des Indes occidentales et orientales, autrement dit, de l'Amérique et du monde. Inconsolable d'avoir perdu sa prééminence au profit du pouvoir anglo-saxon montant (le coup de force napoléonien a pu faire un temps illusion), elle chercherait, depuis, son centre et son axe.
Je puiserai un exemple dans la lecture récente d'un roman. Libertin fréquentant les plus grandes capitales (New York, Paris, Rome) – et donc, obsédé par le centre –, le narrateur de Femmes, roman bien connu de Philippe Sollers, vit le déclassement de la France comme un deuil. Mais là où il m'a vraiment intéressé, c'est lorsqu'il digresse sur le «décentrement» de sa langue et de son pays, en l'associant à la perte de l'Amérique : «Je sais pourquoi les Français préfèrent «oublier» l'existence de l'Amérique… Il y a là, pour eux, une humiliation personnelle… (…) Anglais, Italiens, Allemands, Slaves ? Partout… Les Espagnols, eux, ont toute l'Amérique latine, New York est une ville où on parle partout espagnol… Et même chinois !... Le français, en revanche, y est introuvable… Canada ? Québec ? Non, humiliant, c'est le Morvan… L'accent… Un Français à New York ? Regardez-le… Perdu… Déboussolé… Jaloux…» On comprend pourquoi Sollers, dans son essai sur «l'aventure jésuite» (repris dans Éloge de l'infini), parle du Paraguay et non de la Nouvelle-France : c'était comme si elle n'existait pas et ne devait avoir jamais existé.
Et pourtant, il aurait suffi de reconnaître le bâtard de la famille pour ouvrir la boîte aux merveilles. En plus de Marie de l'Incarnation, pour moi l'une des plus flamboyantes amoureuses de son siècle, Sollers aurait alors pu faire la connaissance de Joseph-François Lafitau, compatriote de Bordeaux, sorte de Montesquieu jésuite du Nouveau Monde, auteur d'une captivante étude d'anthropologie sur les mœurs des Iroquois, traduite à l'époque en allemand et en néerlandais, et qui aurait même circulé, dit-on, jusqu'en Chine. Lafitau était aussi naturaliste et a découvert le ginseng en Amérique du Nord (autre lien chinois). Ajoutons que les marchands de Bordeaux et de La Rochelle ont tenté de rétablir des relations avec le Canada au long du XIXe siècle, longtemps après la cession à l'Angleterre. On peut imaginer le livre merveilleux que Sollers aurait pu tirer d'une rencontre avec Lafitau et, par son entremise, avec «l'Amérique fantôme» morvandelle.
Vous présentez Marie de l'Incarnation comme un grand écrivain, à l'égal de Madame de Sévigné. Le lecteur français, surpris, réclame des preuves ! Pourriez-vous nous citer des passages à titre d'exemples ?
Ce n'est pas moi, mais Henri Bremond qui, dans son Histoire littéraire du sentiment religieux, l'inscrit dans la tradition française du XVIIe siècle. C'est le côté «femme du monde» de Marie, son raffinement et sa hauteur d'âme qui le fascinent, bien que, sans le moindre doute, cette contemplative fût spirituellement étrangère à ce qu'on appelle «le monde». Pour illustrer son propos, il cite le passage d'une lettre que je reprends aussi dans mon livre, où, à près de 70 ans, elle raconte les aventures de Des Groseilliers («un homme de beaucoup d'esprit», qu'elle a connu plus jeune), qui a retourné sa veste pour faire fortune en Angleterre avec son compagnon, le coureur des bois Radisson. Elle le fait avec une allégresse, un style enjoué, une absence de jugement et une distance (et donc, avec une ironie) que n'aurait pas renié, en effet, Madame de Sévigné.
Celle que Bossuet appelait la « Thérèse d'Avila du Nouveau Monde » aurait tout à fait sa place dans la Pléiade aux côtés de la Thérèse d'Avila de l'Ancien Monde.
Carl Bergeron
Marie de l'Incarnation est une figure très attachante, qui alterne entre l'intellectualité mystique (aucune «effusion» chez cette femme, qui se méfiait des leurres de l'imagination) et l'art aiguisé du portrait moraliste, la pointe «méchante» en moins. Elle partage aussi avec Madame de Sévigné un «destinataire privilégié», en l'occurrence un fils et non une fille : Claude Martin, qu'elle dut abandonner avant d'entrer chez les Ursulines, et avec qui elle a entretenu un dialogue outre-Atlantique tout au long de sa vie.
Bremond rêvait à une synthèse entre La Rochefoucauld et Marie de l'Incarnation, entre les moralistes du XVIIe et le levain mystique de la Réforme catholique. Cette tension créatrice court d'ailleurs en filigrane de toute l'histoire de la Nouvelle-France. Le jeune baron de Lahontan (il a 17 ans à son arrivée en Nouvelle-France), lecteur de Pétrone, Lucien et Anacréon, côtoie dans la brousse américaine les jésuites venus pour le Christ ; le gallican Frontenac, entre deux soupers avec Kondiaronk (le plus français des chefs amérindiens), côtoie Mgr de Saint-Vallier, qui cherche à interdire le Tartuffe de Molière. L'histoire de la Nouvelle-France et, par extension, celle du Québec, l'histoire du fait français dans la sauvage et immense Amérique est une histoire baroque, où les contraires s'appellent et se répondent. Y a-t-il plus baroque que la Grande Paix de 1701, admirable conclusion de la diplomatie de Frontenac et de Kondiaronk, qui fit converger par centaines à Montréal les canots d'une quarantaine de nations amérindiennes ? Jamais Montréal ne fut plus brillante que pendant ces trois semaines de juillet et d'août 1701, où le verbe amérindien fusionna avec la civilisation française, et où la pompe du siècle de Louis XIV s'empanacha de plumes, de danses et de chants amériquains (Le terme «amériquains», ainsi orthographié, est un emprunt stylistique voulu à l'ancienne graphie, NDLR).
Marie de l'Incarnation est une chroniqueuse attentive des débuts de ce Nouveau Monde. La Correspondance et l'ensemble de ses écrits ont un triple intérêt : littéraire, théologique et historique. Celle que Bossuet appelait la «Thérèse d'Avila du Nouveau Monde» aurait tout à fait sa place dans la Pléiade aux côtés de la Thérèse d'Avila de l'Ancien Monde. Ce serait un événement considérable pour la France comme pour le Québec, et j'ajouterais même, pour la littérature universelle.
Vous avez entrepris de tirer d'un semi-oubli une haute figure, mais tout autant de méditer sur le destin du Québec d'aujourd'hui. Quel lien faites-vous entre les deux ?
J'aime votre formule : semi-oubli. Marie de l'Incarnation a été, bien sûr, l'objet d'études et de monographies, mais il me semblait urgent de la délivrer du carcan des études savantes, pour en faire un personnage vivant et même, ce qui peut paraître téméraire vu sa vocation mystique, familier – c'est si vrai que je l'appelle, sans y penser, «Marie» ou la «belle Marie» dans la vie de tous les jours.
Je n'ai pas eu besoin de faire le lien avec le Québec puisqu'elle le fait elle-même. Lorsqu'elle s'offre à Dieu en sacrifice pour le Canada, elle s'unit à jamais au destin du pays qui va de Tadoussac à Montréal, jusqu'aux Pays d'en haut (Les Grands Lacs) : elle étend la souveraineté de son Amour dans l'espace comme dans le temps, et en fait une matrice inépuisable d'éternité, puisque pour reprendre ses mots, la «sainteté veut toujours croître, et ses accroissements montrent qu'elle est véritable». C'est donc dire que Marie est la contemporaine de tous les siècles et, en particulier, de ceux qui viennent : elle n'est pas derrière mais devant.
Le catholicisme a été, pendant la Révolution tranquille, assimilé à un cléricalisme et, à ce titre, passionnément rejeté. Votre démarche participe-t-elle d'une volonté de réconcilier le Québec avec son passé et son héritage ?
J'espère que non. Le langage de la «réconciliation» appartient aux hommes d'État, soit aux gardiens de la cité : c'est une fonction que je respecte et que je comprends, mais qui n'est pas la mienne. Pour moi, le rôle des écrivains est autre et consiste moins à «rassembler» et à «réconcilier», qu'à «transfigurer» l'héritage et à «révéler» le sens de la liberté, en hauteur comme en profondeur.
Je veux donner à mon demi-pays, à la culture dont je suis issu, une terre neuve et un ciel neuf, où se réalise en plénitude la vraie vie vécue.
Carl Bergeron
À la limite, il s'agit moins d'atténuer les points de tension que de les aggraver, non pour se complaire dans l'affrontement, mais pour engendrer à partir d'un passé jugé à tort inaccessible et stérile, de nouvelles coordonnées de création, de nouveaux abîmes de sens, de nouveaux plateaux d'invention : je veux donner à mon demi-pays, à la culture dont je suis issu, une terre neuve et un ciel neuf, où se réalise en plénitude la vraie vie vécue. Ce n'est pas un «projet collectif», mais un projet méta-politique, qui fait de la liberté de l'esprit la valeur première, contre toute forme de réduction médiatique, idéologique ou communautaire.
Depuis la Révolution tranquille, le Québec a connu des professeurs d'université qui ont versé dans «l'ingénierie identitaire», et prétendu forger des représentations collectives pour le «réconcilier» avec son passé. Cela n'a jamais marché, parce que les intellectuels agissent à un niveau non primordial : ils restent au niveau du discours et du concept, et sont étrangers au pouvoir de transfiguration de la parole. Ils sont peu sensibles au mystère de l'être, ne savent pas répondre à la soif d'infini et, encore moins, engager un dialogue de vie avec les morts, les héros et les saints de leur pays. Ils ont fait de la culture et de l'histoire leur objet d'étude, mais ce ne sont pas eux qui la créent ou la font : il n'est pas, de fait, en leur pouvoir de faire bouger les lignes de fond de l'identité et de la mémoire. Toute sécularisée qu'elle soit, la société québécoise demeure profondément cléricale, et a substitué l'État-Providence à l'ancien «État dans l'État» de l'Église. «L'orgueil clérical» – en particulier chez les universitaires – y est encore très fort.
Méditant sur le Québec, vous écrivez que, depuis 1763, «l'élite de la jeunesse » a eu en partage le sentiment d'habiter une contrée «où la recherche des valeurs supérieures est punie plutôt que récompensée ». Pourquoi un jugement si sévère ?
Je n'ai que de l'affection et de l'estime pour le petit peuple courageux, qui, après la Conquête, ne formait plus que 60.000 habitants dispersés sur les rives du Saint-Laurent, et a entrepris de retourner dès 1792 les institutions britanniques à son avantage, pour construire morceau par morceau une démocratie, avant d'émerger en force au XXe siècle pour reprendre le contrôle de son économie et de son destin.
Les ancêtres des Québécois, les «Canadiens» (le conquérant leur a volé leur nom après 1840, quand il s'est mis à les étiqueter du nom frauduleux de «Canadiens français», pour mieux se définir lui-même en retour comme le «Canadien» de référence : perfide Albion), pratiquaient au temps de la Nouvelle-France «la petite guerre», inspirée des Amérindiens. Depuis 1763, la «petite guerre» du David canadien contre le Goliath anglais n'a jamais vraiment cessé, sinon lors de la Révolution tranquille, quand les Québécois ont cru qu'ils pourraient faire la « grande guerre » et obtenir leur indépendance.
À défaut de léguer un pays, la Révolution tranquille a légué un demi-pays, ce qui est déjà immense, pour un peuple qui était censé disparaître et a littéralement été tiré de l'oubli de l'Histoire. Il faut rappeler dans quel état se trouvaient les Canadiens français dans les années 1950. Mais un demi-pays implique une demi-cité et, par conséquent, une hiérarchie des valeurs incomplète. Simone Weil a déroulé dans L'Enracinement ce qui, pour elle, constituait les «besoins de l'âme» dans une vraie cité : l'honneur, la liberté, la grandeur, l'admiration. De deux choses l'une : ou les Québécois forment une frange spéciale du genre humain qui peut aisément se passer des vertus supérieures pour atteindre à la plénitude de la vie, ou les circonstances de l'Histoire ont fait en sorte qu'ils ont été confinés dans un type existentiel moyen, où on a voulu qu'ils se résignent à vivre avec un langage, et donc, une réalité, appauvris. C'est pourquoi, au Québec, le mot de «grandeur» – lorsqu'il est brandi par un compatriote – fait ricaner et se voit systématiquement confondu avec la «grandiloquence». Le désir d'élévation dans les choses de l'esprit y est sous étroite surveillance, il y est fréquemment rabaissé et puni.
Le projet québécois n'est pas terminé : il est encore largement ouvert, et le restera tant que ses penseurs, poètes et artistes ne se contenteront pas du type existentiel moyen, et continueront de rechercher en français, bien ancrés dans leur réalité et dans leur histoire, les sommets de l'âme et de l'esprit. C'est une tâche exigeante mais, me semble-t-il, magnifique, propre à refaire du Québec un sujet de désir et d'émulation.
En définitive, il manquerait au Québec de redécouvrir ses figures fondatrices, comme Marie de l'Incarnation, qui ouvrent sur la transcendance, pour donner sa pleine mesure ?
L'aliénation du type existentiel moyen ou, pour le dire en des mots canadiens-français, de la «p'tite vie», ainsi que la menace permanente de la «sortie de l'Histoire» ne sont plus une expérience exclusivement québécoise. Il suffit d'ouvrir un roman de Michel Houellebecq pour le comprendre.
Le «mauvais infini» – ce que Dostoïevski appelait très justement «les démons» – s'est invité en Occident et a pris possession de la cité pour redessiner la réalité à sa fantaisie : l'homme et la femme n'existent pas, les nations n'existent pas, le génie en art et en littérature de même, tandis que les héros et les saints sont tous, dans les faits, des salauds et des porcs. Voilà l'horizon prétendument respectueux de la diversité humaine auquel on veut nous soumettre. L'héritage des Lumières, le refus de l'obscurantisme, la défense de la liberté d'expression, les bienfaits de la modernité, j'en suis comme tous les gens de bonne volonté. Ce ne sera toutefois pas suffisant : pour venir à bout du «mauvais infini», il lui faudra opposer un «bon infini», et donc une transcendance qui ne tombe certes pas dans le piège de la certitude dogmatique (personne n'en a envie), mais qui n'en est pas moins sûre d'elle-même, et sait comment métaboliser la culture vers le haut et le sacré.
Dans la nouvelle donne, la France aura désespérément besoin de refaire le plein de sainteté, de « forêt infinie » et d'enfance : elle aura besoin de la Nouvelle-France.
Carl Bergeron
Je pense que nous sommes arrivés à la fin d'un cycle à l'échelle de l'Histoire et que, déjà, un nouveau s'est ouvert. Dans la nouvelle donne, la France aura désespérément besoin de refaire le plein de sainteté, de «forêt infinie» et d'enfance : elle aura besoin de la Nouvelle-France, tandis que le Québec aura besoin de faire le plein de sainteté, de «connaissance infinie» et de maturité : il aura besoin de la France. Les deux peuples frères, le bâtard et le royal, le petit et le grand, les derniers et les premiers, auront besoin d'accéder au mystère de l'un et de l'autre pour réaliser la plénitude de leur humanité.
Telle est ma foi et, sans doute, ma folie – mais au «bon infini» n'est-il pas sain et conséquent d'ajouter la «bonne folie» ?