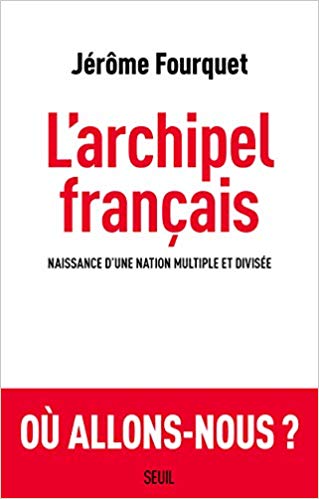Jérôme Fourquet est connu des téléspectateurs français pour ses analyses électorales et sociologiques, en qualité de directeur du département Opinion à l’IFOP (organisme de sondage).
Dans L’Archipel français (Seuil, mars 2019, 384 pages, 22 euros), il montre que la France homogène du dernier millénaire a laissé place à un pays profondément hétérogène, avec déjà un cinquième des naissances dans des familles issues de l’immigration musulmane et africaine. C’est une réalité irrévocable qu’il importe de prendre en considération. Les partis politiques le font-ils ? Ils en sont loin...
C’est la deuxième révélation de Jérôme Fourquet : la fin de l’affrontement droite-gauche par lequel les citoyens de toutes les classes sociales s’efforçaient depuis deux siècles d’apporter une solution aux grands enjeux de l’heure. À cette opposition traditionnelle a succédé une opposition de classe avec un bloc dominant et un bloc protestataire. Le premier, à cheval sur les anciennes droite et gauche, réunit les gagnants de la mondialisation et les bénéficiaires de revenus fixes (retraités) ; le second réunit les perdants de la mondialisation et tous les citoyens qui préfèrent un renforcement des solidarités nationales à une mise en concurrence de tous contre tous…
André Larané
Le christianisme de retour dans les catacombes
 Jérôme Fourquet décrypte la société française du XXIe siècle sous plusieurs angles : religieux, ethnique, social et électoral.
Jérôme Fourquet décrypte la société française du XXIe siècle sous plusieurs angles : religieux, ethnique, social et électoral.
Côté religieux, il fait un premier constat : la déchristianisation du pays est arrivée à son terme. Les confessions chrétiennes ne structurent plus la société et les mœurs comme c’était encore le cas au milieu du XXe siècle. Ainsi, « la montée en puissance de phénomènes aussi distincts que la crémation, le tatouage ou l’animalisme et le véganisme ne doivent pas être analysés comme de simples phénomènes de mode, mais comme les symptômes d’un basculement civilisationnel et anthropologique majeur. Au travers de ces nouvelles pratiques, des pans entiers du référentiel judéo-chrétien, qu’il s’agisse du rapport au corps ou de la hiérarchie entre l’homme et l’animal, apparaissent comme battus en brèche et obsolètes. » (15) [NB : les numéros entre parenthèses indiquent la page du livre].
En 2012, le taux de baptisés était de 88% chez les plus de 65 ans et n’était plus que de 65% chez les 18-24 ans. La déchristianisation apparaît plus brutale encore dans l’évolution du nombre de prêtres. Ils étaient 25 000 en 1990 et ne sont plus que 12 000 en 2015.
Plus anecdotique, la diversification des prénoms est néanmoins très représentative de ce phénomène : « De 1900 à 1945, le nombre de prénoms différents donnés chaque année est demeuré remarquablement stable, avec en moyenne une palette de 2000 prénoms. (…) Le phénomène s’est ensuite emballé avec le franchissement de la barre des 8000 prénoms différents au milieu des années 1990, puis 10000 en 2001 et 12000 en 2005… » (88). En 1900, une petite fille sur 5 était prénommée Marie. Dans les années 1940-1960, par une première prise de distance avec la tradition, on a vu se multiplier les prénoms composés à partir de Marie (Marie-Hélène…). Aujourd’hui, les uns et les autres sont ultra-minoritaires !
Le défi du multiculturalisme
Dans L’Archipel français, Jérôme Fourquet porte une grande attention aux choix des prénoms tels que reflétés par le fichier de l’INSEE. Il a mené en particulier un travail inédit sur le pourcentage de garçons portant un prénom arabo-musulman parmi l’ensemble des nouveaux-nés mâles, année après année, depuis 1900.
C’est « un indicateur robuste lorsqu’il s’agit d’évaluer le poids des personnes d’ascendance arabo-musulmane dans l’ensemble d’une classe d’âge. (…) La trajectoire de cette courbe est des plus impressionnantes et montre de manière très nette l’une des principales métamorphoses qu’a connues la société française au cours des dernières décennies : alors que la population issue de l’immigration arabo-musulmane était quasiment inexistante en métropole jusqu’au milieu du XXe siècle, les enfants portant un prénom les rattachant culturellement et familialement à cette immigration représentaient 18,8% des naissances en 2016, soit près d’une naissance sur cinq » (136).
On note sur la courbe en question que la barre des 2% a été symboliquement franchie en 1964, deux ans après la fin de la guerre d’Algérie, avec l’arrivée de travailleurs et aussi de réfugiés (harkis).
La proportion de 18,8% relevée parmi les naissances de 2016 est très supérieure au taux de personnes qui se définissent comme musulmanes ou d’ascendance musulmane, lequel varie de 6 à 8% selon les enquêtes récentes. Mais il est à souligner qu’elle caractérise seulement les naissances « musulmanes » en 2016. Ces naissances sont plus nombreuses d’année en année du fait du flux d’immigration et d’une plus forte fécondité des femmes issues de cette immigration. Notons aussi, ce qu’omet Jérôme Fourquet, que parmi ces enfants qui portent un prénom « arabo-musulman », de plus en plus sont aussi issus de l’immigration sahélienne (Sénégal, Mali, Niger…).
La conclusion est tirée par l’auteur lui-même : « Dans cette France qui vient, la part de la population issue des mondes arabo-musulmans représentera mécaniquement, du fait du renouvellement des générations, un habitant sur cinq, voire sur quatre, si la tendance haussière observée depuis le début des années 2000 se poursuit. On mesure à la lecture de ces chiffres que la société française est devenue de facto une société multiculturelle, et que notre pays ne connaîtra plus jamais la situation d’homogénéité ethnoculturelle qui a prévalu jusqu’à la fin des années 1970. Il s’agit là sans conteste d’un basculement majeur, et sans doute la cause principale de la métamorphose qui se produit sous nos yeux et aura (a déjà) des conséquences profondes » (140).

Ce basculement compte de francs succès : une bonne partie de l’immigration musulmane a ainsi pu se fondre dans la société française, comme l’attestent le grand nombre de recrues dans l’armée ou encore, plus anecdotique, la participation de jeunes musulmans aux courses de taureaux camarguaises, à Lunel, une ville pourtant marquée par le salafisme d’un côté, le vote frontiste (Rassemblement national) de l’autre.
Mais parallèlement, le sociologue observe un repli communautaire très net et une réislamisation depuis le début des années 2000. Ce qui trouble le plus Jérôme Fourquet est le renforcement de l’endogamie (mariage entre soi) dans les populations issues de l’immigration turque, maghrébine et sahélienne (à l’exclusion de l’immigration asiatique), cette endogamie ethno-religieuse étant même facilitée par les sites de rencontre communautaires ! Le sociologue croit observer que les jeunes femmes tentent d’y échapper en fuyant les quartiers à trop forte concentration musulmane pour des quartiers plus « français » où elles pourront vivre selon leur choix.
Si l’endogamie et le repli communautaire se renforcent, Jérôme Fourquet en voit la raison dans le fait que « l’arrivée régulière de membres de la communauté d’origine favorise toujours la persistance des mariages endogames et contribue à maintenir le groupe dans le bain culturel du pays d’origine » (179).
Toulouse est pour Jérôme Fourquet un excellent observatoire de la fracturation ethno-sociale du pays. Cette agglomération est la plus dynamique de France avec le plus gros site industriel (Airbus, 11500 salariés), dix mille chercheurs, cent dix mille étudiants, le 2e CHU (centre hospitalier universitaire) du pays etc. etc. Mais c’est aussi la ville du tueur Mohamed Merah et du Mirail, un ensemble « social »de quarante mille habitants (essentiellement maghrébins) avec 50% de chômeurs chez les plus jeunes. Le trafic de la drogue est la seule activité qui y prospère en lien avec la radicalisation religieuse. À Toulouse comme à Carcassonne, Aulnay… Jérôme Fourquet montre des quartiers qui échappent au contrôle des autorités, laissant le champ libre aux délinquants locaux.
Sans prétendre y voir une relation de cause à effet, il met en regard « l’explosion de la consommation de cannabis avec la non moins spectaculaire diminution de la consommation d’alcool » ! Pour répondre à la demande croissante de cannabis (1,4 million de consommateurs réguliers, au moins dix fois par mois), « toute une économie souterraine du deal s’est mise en place sur le territoire ». Elle emploierait pas moins de deux cent mille personnes (davantage que la SNCF ou EDF ! Amusant : « Toutes choses égales par ailleurs, on pourrait établir ici un parallèle avec l’ampleur de l’activité du faux-saunage dans les bocages de l’Ouest au XVIIIe siècle. Dans ces terroirs pauvres, situés sur les marches de Bretagne, région non soumise à la gabelle, la contrebande de sel battait son plein et impliquait une bonne partie de la population locale » (199).
L’école est aussi le théâtre d’une ségrégation ethnoculturelle de plus en plus poussée, battant en brèche le discours officiel sur le « vivre-ensemble » (203).
Selon une note de l’INSEE, « si le retard scolaire est fortement indexé sur le niveau social des parents, la nationalité des élèves pèse aussi énormément. On note ainsi que si 11,8% des élèves ayant la nationalité française avaient au moins un an de retard lors de leur entrée en 6e, la proportion était quasiment trois fois plus importante (32,4%) parmi leurs camarades étrangers. (…) Une des raisons expliquant ces piètres performances réside dans la ségrégation ethnoculturelle qui s’est développée à bas bruit dans les établissements scolaires français » (208).
Mais qu’y faire ? François Pupponi, député socialiste et ancien maire de Sarcelles, cité populaire au nord de Paris, expose le dilemme :
« Soit on impose aux parents de mettre leurs enfants dans le collège public du secteur, et dans ce cas, ils vont partir et il n’y aura plus de mixité dans le quartier. Soit on donne la possibilité de mettre les enfants dans le privé ou le public. Le choix de laisser les écoles privées permet à ces classes moyennes de rester dans ces villes, d’y habiter, de payer des impôts » (210).