Jusqu'à tout récemment le Canada s'est toujours gardé de jouer les favoris dans le conflit au Proche-Orient, tout en prenant soin d'aligner sa politique sur celle des Nations unies. On peut faire remonter cette tradition à l'époque de Louis Saint-Laurent, alors que son ministre des Affaires extérieures, Lester Pearson, réussit à dénouer la crise de Suez en 1956 et se reçut le prix Nobel de la paix. Depuis, notre diplomatie a donné corps et consistance à l'existence même du Canada.
Le premier ministre Harper s'est éloigné de cet héritage en appuyant sans réserves l'offensive d'Israël contre le Hezbollah au Liban. Il a qualifié la riposte d'Israël de «mesurée» -- l'histoire retiendra sans doute cette phrase -- malgré l'utilisation d'une force excessive mettant en péril la population civile du Liban (détruisant ponts, routes, autoroutes, centrales électriques, aéroports, etc.).
Le plus surprenant, c'est que M. Harper ne s'est donné aucune marge de manoeuvre, ce qui lui aurait permis, à l'instar de Kofi Annan, de réclamer une enquête sur les circonstances entourant le bombardement d'un poste d'observation de l'ONU qui coûta la vie à un Canadien, ou de reconnaître le bien-fondé de cette nouvelle doctrine internationale sur la «responsabilité de protéger» les populations civiles. Cette doctrine avait été parrainée par le Canada et endossée par les chefs d'État lors d'un sommet des Nations unies en 2005.
Éviter la discorde
Quels que soient les facteurs qui ont justifié la décision du premier ministre (solidarité avec le monde anglo-saxon, souci de venir en aide à un allié qui doit lutter sans cesse pour sa survie ou réflexe naturel de la droite canadienne d'aligner sa politique sur celle de Washington), il n'en reste pas moins que ces raisons se heurtent à des intérêts supérieurs et à des impératifs qui touchent les fondements mêmes de l'existence du Canada, soit son unité et sa politique étrangère qui en est le reflet. Une règle élémentaire voudrait que notre politique étrangère, dans un monde aussi fragmenté, évite de semer la discorde ou de nourrir les antagonismes entre nos diverses communautés culturelles et religieuses.
Au Québec, Jean Charest l'a compris et s'est empressé de mettre sur pied un programme d'accueil humanitaire pour les ressortissants libanais qui arrivaient au Québec.
Chose certaine, le Parti québécois et le Bloc québécois, qui ont tous deux dénoncé la position du Canada, ne manqueront pas d'exploiter cette crise en démontrant que seul un Québec indépendant pourra offrir aux Québécois une politique extérieure à la hauteur de leurs aspirations.
Citoyens du monde ! Les Canadiens le sont devenus, surtout dans les grandes villes. Plus que jamais ils sont sensibles aux questions internationales et à tout ce qui agite la planète (pauvreté, environnement, terrorisme, conflits, etc.).
Ils logent à l'enseigne de la compassion, du respect des droits humains, et ont un sens très vif du fairplay. Aussi ressentent-ils une grande fierté lorsque nos dirigeants ne craignent pas de s'afficher ou de défendre ces valeurs, qui bien souvent nous distinguent des Américains. C'est un facteur dont on ne peut sous-estimer l'importance dans le contexte de l'unité nationale.
Le besoin croissant de médiateurs
Bien sûr que notre pays doit toujours évaluer sa situation par rapport à celle de son puissant voisin et ne prendre ses distances que lorsque les circonstances l'exigent. Jean Chrétien l'a fait lorsqu'il a refusé de participer à la guerre en Irak, décision en tous points conforme à celle des Nations unies. En revanche, Paul Martin a peut-être cédé trop facilement au lobby anti-américain de son parti lorsqu'il a décidé de ne pas participer au projet de bouclier anti-missile américain.
Sur le plan international, un nouveau rapport de forces est en train de s'établir si on en croit les analystes. Dans un monde multipolaire, les États-Unis ne seront plus les seuls détenteurs de la puissance, mais devront composer avec d'autres entités, notamment l'Union européenne, la Chine, l'Inde, le Brésil, sans parler de la force déstabilisatrice de l'islam; donc un ensemble planétaire où les rivalités seront plus intenses et les intérêts plus diversifiés. Cela favorisera l'émergence de médiateurs chevronnés, capables de s'imposer et de rassembler au-delà des religions, des idéologies des ou dictatures.
Le Canada pourrait bénéficier d'une telle situation, d'autant qu'il n'est pas dénué de pouvoir, comme l'a rappelé Stephen Harper lorsqu'il a qualifié notre pays de «super-puissance énergétique» lors de son récent passage à Londres.
Force est de reconnaître que les événements des dernières semaines ont placé le Canada sur la défensive. Aussi faut-il espérer que Stephen Harper parvienne à donner plus d'acuité et d'indépendance à sa politique étrangère. Ce «nouveau» Proche-Orient prôné par Condoleezza Rice pourrait lui en fournir l'occasion. Mais les États-Unis n'inspirent plus confiance dans la région. Le Canada pourra-t-il plus facilement s'interposer ?
D'autre part, Kofi Annan voudrait voir le Hezbollah, l'Iran et la Syrie participer aux négociations visant un règlement global. Une véritable trêve est-elle possible sans un échange de prisonniers ? Et le déploiement d'une force internationale doit-il dépendre de l'ONU, qui est déjà présente au Liban, ou d'un autre institution ? Autant de questions sur lesquelles le gouvernement canadien pourrait vouloir se prononcer afin de recouvrer une partie de son autonomie.
Jean Chevrier
_ Avocat et éditeur, l'auteur a enseigné les relations internationales et l'histoire politique du Canada avant de devenir conseiller politique de Robert Stanfield et de l'ancien premier ministre Joe Clark.
Guerre au Proche-Orient - L'autonomie du Canada
Par Jean Chevrier






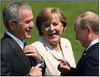
















Laissez un commentaire Votre adresse courriel ne sera pas publiée.
Veuillez vous connecter afin de laisser un commentaire.
Aucun commentaire trouvé