La Proclamation royale du 7 octobre 1763 est la première constitution imposée aux Canadiens. [1] Rédigée par un trafiquant d’esclaves devenu expert en politique coloniale, cette constitution a profondément marqué nos institutions, notre droit, notre histoire politique et constitutionnelle. Dans un article précédent, nous avons abordé les circonstances de sa rédaction. Cette fois-ci, nous allons traiter de sa substance. Il sera tout particulièrement question de l’une de ses principales dispositions qui fut interprétée à l’époque comme ayant abrogé d’un trait les lois et coutumes du Canada afin de les remplacer par les lois et coutumes de l’Angleterre. [2] Était-ce vraiment le cas ?
Examinons.
Après avoir disposé de la question des frontières, Sa Majesté annonce à ses anciens et nouveaux sujets qu’elle a décidé de leur octroyer des assemblées représentatives qui pourront, de concert avec le gouverneur en conseil, adopter des « lois, statuts et ordonnances afin d’assurer la paix, l’ordre et le bon gouvernement » dans chaque colonie. Ces assemblées seront mises en place dès que la situation locale le permettra.
Entre temps, Sa Majesté leur donne l’assurance qu’elle veillera à leur bien-être et à leur sécurité. En ce sens, elle déclare : « Dans l’intervalle, et jusqu’à ce que ces assemblées puissent être convoquées, tous ceux qui habitent, ou iront habiter nosdites colonies, peuvent avoir confiance en Notre royale protection et compter sur Nos efforts pour leur assurer les bienfaits des lois de Notre royaume d’Angleterre. »
À cette fin, elle ajoute : « Nous avons donné aux gouverneurs de Nos colonies le pouvoir de créer et d’établir, de l’avis de Nos conseils, des tribunaux civils et des cours de justice […] pour entendre et juger toutes les causes, aussi bien criminelles que civiles, suivant la loi et l’équité, conformément autant que possible aux lois de l’Angleterre. »
Ainsi, dans un premier temps, Sa Majesté promet à ses sujets qu’ils pourront décider de leurs lois, statuts et ordonnances en toute liberté. Dans un deuxième temps, elle leur donne l’assurance qu’ils pourront, d’ici là, se prévaloir des lois de l’Angleterre, ce qui est de bon augure, compte tenu que ces lois ont la réputation d’être d’incomparables chefs-d’œuvre du génie humain. [3] Enfin, dans un troisième temps, elle les informe qu’elle a déjà pris des dispositions pour que ces gestes de bienveillance prennent effet sans tarder. Voilà qui est pas mal pour un peuple qui vient de se faire écraser !
Or, où Sa Majesté dit-elle qu’elle a, ou qu’elle va, abroger les lois et coutumes du Canada ? Nulle part ! Où Sa Majesté dit-elle qu’elle a, ou qu’elle va, imposer les lois et coutumes de l’Angleterre ? Nulle part ! Ces promesses sont bel et bien des gestes de bienveillance de sa part. Dans l’ordre des idées, un geste de bienveillance est un acte qui procure un avantage à quelqu’un sans contrepartie de sa part. Bref, un geste de bienveillance, c’est un simple geste de générosité.
Afin de bien saisir la teneur de ces promesses, il est important de les examiner à la lumière de l’état du droit anglais relatif aux colonies acquises par « conquête, cession ou traité ». Ainsi, dès le début du XVIIè siècle, la jurisprudence anglaise avait établi que les habitants de ce type de colonies continuaient à vivre sous la protection de leurs propres lois et coutumes. Ce principe était à ce point établi qu’il était appliqué même dans le cas où des colons et planteurs anglais étaient nombreux à y accourir et à s’y installer. Pour illustrer la vigueur de cette pratique, le cas de la Jamaïque, acquise à l’Angleterre en 1655, nous en fournit un exemple des plus éloquents. Examinons en quelques mots.
La conquête de la Jamaïque [4]
Île des Caraïbes, la Jamaïque était originellement habitée par des indiens arakas. Le 4 avril 1494, Christophe Colomb y débarque et en prend possession au nom de l’Espagne. L’île est alors occupée par des colons et planteurs espagnols. Ils y fondent une capitale, Santiago de la Vega, et y installent leur gouvernement. Puis les années passent.
Plus de cent-soixante ans plus tard, un amiral anglais, William Penn, débarque dans l’île avec un corps expéditionnaire pour s’en emparer. Suite à une victoire rapide, les Espagnols en sont expulsés manu militari. Les esclaves, eux, se réfugient dans l’épaisse forêt tropicale pour recouvrer leur liberté et se regrouper sous forme de hameaux. Pour leur part, les conquérants s’installent dans la capitale, rebaptisée Spanish Town, pour y établir un gouvernement provisoire. Colons, planteurs, pirates et corsaires anglais y accourent en masse. L’île devient riche et prospère. Bien entendu, il ne tarde pas à y avoir des conflits que les tribunaux doivent entendre et régler. Mais entendre et régler en vertu de quelles lois ? Sans doute les lois de l’Angleterre puisque la colonie est anglaise et que ses habitants le sont tout autant.
Or, à Londres, le Conseil privé de Sa Majesté ne l’entend pas ainsi. Il rappelle aux autorités locales l’état du droit sur le sujet : « Votre colonie ayant été acquise par conquête, vos lois et coutumes sont celles qui prévalaient à cette époque ! » Quant aux tribunaux, ils jugent exactement dans le même sens. Les colons en sont sidérés ! L’idée de vivre sous des lois et coutumes qu’ils ne connaissent pas les révulse au suprême degré. Ils s’indignent, ils s’insurgent. Mais à Londres les autorités ne bronchent pas. Ulcérés, les colons sont déterminés à se battre. Pourquoi tant de tracasseries ? Ils ne réclament pourtant que le droit de vivre comme des Anglais avec leurs lois et coutumes !
Année après année, les colons renouvellent leurs représentations auprès du Conseil privé. Ils retiennent les services des meilleurs avocats de Londres pour les représenter. Mais rien n’y fait ! La réponse du Conseil privé ne varie pas d’un iota. Ce désaccord persiste jusqu’en 1722.
Cette année-là, soit soixante-sept ans après la conquête, la rigidité du Conseil privé commence à s’attendrir. Suite à un engagement financier de la part de l’assemblée législative de l’île, le Conseil privé consent à se faire plus compréhensif. Sous promesse d’assumer la totalité des dépenses du gouvernement civil, les Jamaïcains sont enfin autorisés à se prévaloir du droit anglais. Mais pas de tout le droit anglais ! Seulement les lois et coutumes applicables à leur situation. Il ne peut être question d’y introduire la totalité de ce droit.
Tel était donc l’état du droit colonial anglais en 1655, et tel il était encore en 1763. Le compromis de 1722 n’avait été qu’une parenthèse, qu’une exception en réponse à une situation particulière accompagnée d’une promesse alléchante. L’argent avait attendri les ministres de Sa Majesté. Alors qu’en sera-t-il dans la « Province of Quebec » ? Ses nouveaux sujets devront-ils supplier Sa Majesté pendant des dizaines d’années avant qu’ils ne soient autorisés à bénéficier de la protection des lois et coutumes de l’Angleterre, chef-d’œuvre inégalé du génie humain ? La réponse ne tardera pas.
Le gouvernement de la « Province of Quebec »
En octobre 1763, les Anglais ne forment que 3/10 de 1 % de la population de la « Province of Quebec ». Mais leur titre de conquérants a fait d’eux une bande de petits vaniteux à qui tout est dû. Ainsi, ils s’imaginent pouvoir exiger un ordre de droit à leur avantage exclusif, comme s’ils formaient 99,7 % de la population. Ils se considèrent comme une majorité politique, justifiée d’imposer sa volonté. N’ayant pas la moindre idée du droit international coutumier en matière de cession de territoires, ils assimilent les vaincus à des esclaves sans droits qui doivent s’écraser ou s’effacer devant eux. Alors qu’ils n’étaient rien en Angleterre, ils se sont transformés en une sorte de noblesse coloniale à qui il ne manquait que des titres de ducs, de marquis et de comtes.
Lorsque le texte de la Proclamation royale arrive à Québec, ces Anglais ne mettent pas de temps à s’entendre sur l’interprétation à donner à l’expression « pour leur assurer les bienfaits des lois de Notre royaume d’Angleterre ». Selon eux, il ne fait aucun doute que cette disposition a été écrite à leur avantage à eux – 3/10 de 1 % de la population – et non à celui des vaincus. Ainsi, non seulement ne connaissent-ils rien en droit international coutumier, mais ils ne connaissent rien non plus du droit anglais en matière coloniale. Bref, Sa Majesté ne peut pas ne pas avoir tranché en faveur de l’excellence des lois et coutumes de l’Angleterre.
C’est pourtant un lieu commun du droit anglais de dire que seule une loi négative du Parlement peut modifier ou abroger une loi existante. Une loi simplement affirmative, sans négation implicite ou explicite, n’abroge strictement rien. La jurisprudence anglaise n’a jamais prétendu autre chose que ça.
Que les Canadiens ne connaissent rien de ces lois et ne parlent pas un traître mot d’anglais, rien n’y fait ! En milieu colonial, la loi n’a d’autre finalité que de servir les intérêts du plus fort. L’idée qu’elle soit au service du bien commun ne veut strictement rien dire. Les conquérants sont donc en droit de revendiquer un système de justice qui leur donne l’avantage de la situation. En Nouvelle-France, pourtant, le système juridique avait favorisé un ordre de droit qui permettait « au faible et au fort de jouir d’un droit égal ». [5]
Le droit et la justice en Nouvelle-France
En Nouvelle-France, l’administration de la justice avait été avant-gardiste et d’une qualité enviable. En avril 1663, Louis XIV avait fait adopter une ordonnance à l’effet que le seul et unique droit de la colonie serait celui en vigueur dans le ressort du Parlement de Paris. L’idée était aussi simple que novatrice : « Un roi ! un pays ! une loi ! » L’uniformisation du droit à l’intérieur d’une même juridiction constituait une initiative originale de la part du pouvoir civil. En fait, cette idée existait en germe dans le principe d’universalité du droit canon. Il fallait tout simplement le reproduire sur le plan civil. Le Canada, pays neuf où tout était possible, apparaissait comme l’occasion idéale pour créer une sorte de laboratoire de la modernité en matière de droit et de justice.
Ainsi, l’uniformisation et la simplification du droit s’implanteront si naturellement que, pendant près de cent ans, les Canadiens vont vivre et prospérer dans un système légal à ce point réglé qu’il sera à peu près impensable d’en trouver l’équivalent ailleurs en Europe. Montcalm, à son arrivée, en sera si étonné qu’il écrira que, en France, il n’y avait que Paris où l’état d’avancement de la société surpassait celui de Québec. Dans le même sens, des réformateurs anglais, qui cherchaient alors à améliorer l’administration de la justice dans les colonies américaines, iront jusqu’à dire : « Pourquoi ne pas s’inspirer de ce qui se fait en Nouvelle-France ? Là-bas tout est réglé comme un système d’horlogerie ! » En fait, ils avaient entièrement raison puisque la loi y était traitée comme une œuvre de raison qui permettait tant au faible qu’au fort de jouir d’un droit égal.
Ainsi, sans l’avoir voulu ni recherché, les Canadiens vont bénéficier d’un système juridique hors du commun. Ils seront parmi les rares justiciables de l’époque à pouvoir vivre en pleine égalité sous une seule et même loi, à jouir d’une administration de la justice gratuite, moderne, réglée par des codes de procédure écrits, et à bénéficier d’une justice rendue par des juges professionnels et intègres, tenus de prouver leurs compétences.
Le juste milieu entre un capharnaüm et un pandémonium
Nous avons signalé plus haut que les Anglais nouvellement arrivés s’étaient mis d’accord pour conclure que Sa Majesté britannique avait abrogé d’un trait les lois et coutumes du Canada. Cette conclusion – totalement erronée – sera pourtant mise en application à l’occasion de l’adoption, par le Conseil colonial, de l’Ordonnance du 17 septembre 1764 établissant des cours de justice. Tout, dans cette ordonnance, sera conçu de façon à promouvoir un ordre de droit à l’avantage exclusif des petits conquérants locaux. En fait, cette imposture avait provoqué tant de désordre que l’idée même de justice avait sombré dans un ridicule indescriptible. Pour en savoir un peu plus sur le sujet, consultez sur L'aut'journal l'article intitulé : « L’Ordonnance du 17 septembre 1764 ».
Alors que les Canadiens avaient bénéficié jusque-là d’un système juridique d’une qualité sans égale, les voilà assujettis à un système qui leur est étranger, écrit dans une langue dont ils ne savent rien, administré par des analphabètes dont la seule compétence est d’être Anglais et protestants. Pire encore, les institutions mises en place sont en retard de un à deux siècles sur celles qu’on venait de leur enlever le plus arbitrairement du monde. En voici quelques exemples.
Alors que, dans le droit criminel canadien, il n’y avait que « trois » infractions punies de la peine de mort, il y en aura jusqu’à « deux cent dix » dans le droit anglais. Compte tenu que ce droit privilégiait la protection des fortunes et de la propriété, le moindre manquement à une loi, ignorée par un Canadien, pouvait le conduire tout droit à l’échafaud, et ce, suite à un procès sommaire devant un juge et des jurés unilingues anglais. Par exemple, le vol d’un bien d’une valeur de un shilling – à peu près une vingtaine de dollars aujourd’hui – était « punie » de la peine de mort. Par « punie » il faut comprendre que la mort était en ce cas la peine minimale. Le juge n’avait aucune discrétion. Il n’était qu’un maillon d’une idéologie totalitaire hantée par l’obsession – toute protestante ! – de « tirer vengeance des méchants et de les punir ». En Nouvelle-France, seuls le meurtre, le viol d’un enfant et l’incendie d’un immeuble étaient punis de la peine de mort. D’ailleurs, pendant tout le régime français, on ne comptera que 14 pendaisons, soit un peu moins d’une exécution aux dix ans. La différence considérable entre les deux systèmes résulte du fait que l’esprit du droit canadien, héritier de la tradition du droit naturel, cherchait à maintenir un ordre de justice axé sur la paix et l’harmonie sociale, alors que celui du droit anglais privilégiait un ordre de coercition qui cherchait à terroriser les « méchants et à les punir ». [6] Il faut comprendre ici que, pour les Anglais, les méchants les plus dangereux étaient les pauvres qui osaient s’en prendre à la propriété privée. La justice était d’une férocité implacable à leur endroit. Des enfants de 7 ou 8 ans étaient pendus pour le vol de simples bagatelles. [7]
Comparons la question du droit d’appel en matière criminelle. Le droit français avait reconnu ce droit dès 1580. En 1670, l’appel était même devenu « obligatoire » dans le cas de condamnations à un châtiment corporel ou à la peine de mort. Mieux encore, dans le cas où cet appel échouait, le condamné pouvait se prévaloir d’un deuxième appel devant le Conseil d’État du Roi. Et, en cas d’échec à ce niveau, le condamné pouvait ultimement requérir une lettre de grâce. Sous le régime français, sept Canadiens ont été graciés de cette façon.
Par contre, dans le droit anglais, le droit d’appel ne sera reconnu qu’en 1907 avec l’adoption du Criminal Appeal Act. Entre 1580 pour le droit français, et 1907 pour le droit anglais, il y a une jolie différence de 327 ans. Alors d’où les Conquérants tirent-ils l’idée absurde, si souvent répétée depuis septembre 1760, qu’ils auraient apporté la liberté et le progrès aux Canadiens ? Liberté et progrès pour avoir le plaisir de voir des enfants de 7 ans expirer au bout d’une corde pour le vol d’un crayon, d’une cuillère, d’un bout de pain, d’un mouchoir !
Penchons-nous enfin sur le cas de l’emprisonnement pour dettes. En Nouvelle-France, ce moyen de contrainte avait été abrogé en 1670, alors que, sous le régime des libérateurs, il ne le sera qu’en 1850, ce qui donne une différence de 180 ans. On pourrait continuer ce jeu de comparaisons, institution par institution, et on constaterait que les lois et coutumes du Canada étaient en avance sur le droit anglais de un à deux siècles, selon les institutions. De façon générale, le droit canadien était plus structuré et plus moderne que le droit français lui-même. Cette différence s’explique par le fait que les autorités coloniales françaises, qui jouissaient du concours d’excellents juristes, pouvaient se permettre nombre d’améliorations qui, en France, auraient soulevé des tollés dans un pays écrasé sous le poids des privilèges. [8] En fait, le Canada était un pays neuf où il était beaucoup plus facile de mettre en œuvre les idées les plus innovatrices et les plus propres à favoriser la paix et l’harmonie par une bonne administration de la justice.
Bref, le droit anglais – présenté comme une merveille du génie humain – était dépassé, arriéré, tant en matière civile que criminelle. Il constituait, à proprement parler, un chaos dans lequel les juges et les avocats se perdaient eux-mêmes, un amas confus de solutions étranges, incohérentes, absurdes et contradictoires, un amalgame de pratiques injustes et injustifiables, le plus souvent empruntées à une conception éminemment protestante de la loi, du droit et de la justice. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Soyez assurés que nous y reviendrons !
Christian Néron
L'auteur est Membre du Barreau du Québec, Constitutionnaliste et Historien du droit et des institutions
Références
- ^ Les capitulations de Québec (1759) et de Montréal (1760) – signées par Vaudreuil, un Canadien – font aussi partie de notre constitution, mais elles n’ont jamais eu d’effets réels sur l’évolution de notre droit.
- ^ Les lois et coutumes du Canada, c.-à-d. celles mises en vigueur au pays de 1663 à 1758, n’ont jamais été expressément abrogées par le Parlement de Westminster, ni par aucun parlement d’ailleurs. Il faut donc en conclure qu’elles sont toujours en vigueur compte tenu qu’une loi reste une loi tant et aussi longtemps qu’elle n’a pas été abrogée par l’autorité compétente.
- ^ Au XVIIIe s, ce sont les Anglais qui prétendaient déjà que leurs lois étaient des chefs-d’œuvre du génie humain.
- ^ Jack P. Greene, Peripheries and Center: Constitutional Developments in the Extended Politics of the British Empire and the U.S., 1607-1788, Athens and London, University of Georgia Press, 1906, au chapitre 2.Euripide, Les Suppliantes, 433-434.
- ^ Euripide, Les Suppliantes, 433-434.
- ^ Dans un article à venir, nous allons expliquer l’impact du protestantisme sur l’évolution de la pensée juridique moderne. Les Canadiens ont été parmi les premiers à subir l’impact de ce bouleversement dans les idées.
- ^ Les Anglais n’ont jamais pendu ici des enfants en bas de dix ans, mais il y a de nombreux cas du genre rapportés par des auteurs dans l’Angleterre du XVIIIe s. Peter King, Crime, Justice and Discretion in England, 1740-1820, Oxford, University Press, 2000.
- ^ En France, il y avait toute une gamme de traditions et de privilèges qui empêchaient les autorités d’uniformiser le droit. Ce que les Révolutionnaires feront à partir de 1789 dans une violence absolue avait déjà été réalisée ici sans même que les gens ne s’en rendent compte.
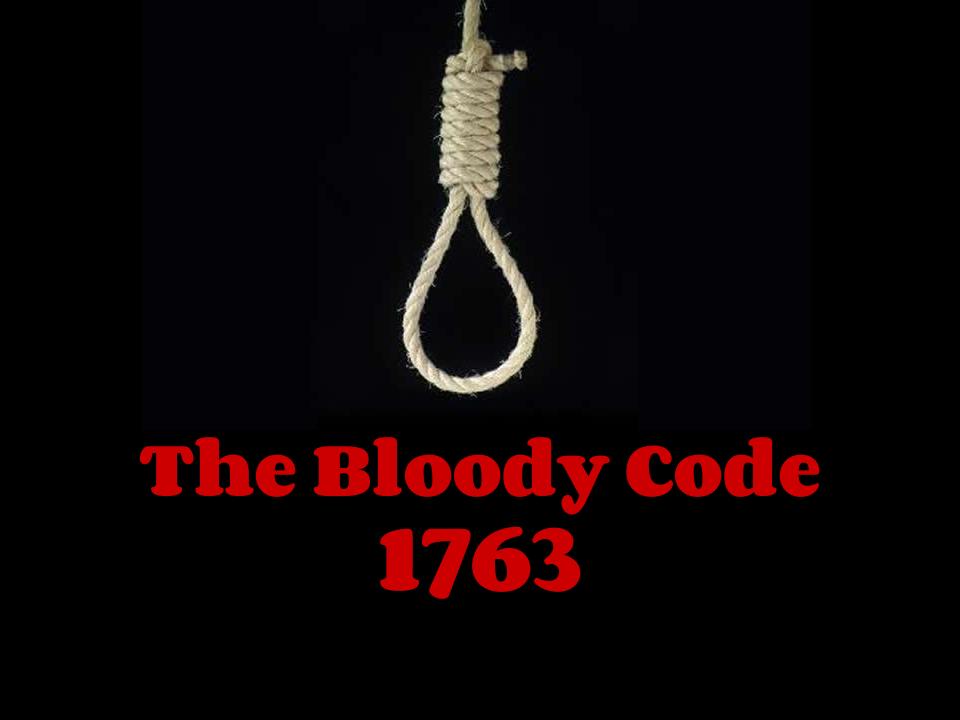



























Laissez un commentaire Votre adresse courriel ne sera pas publiée.
Veuillez vous connecter afin de laisser un commentaire.
Aucun commentaire trouvé