Quand il a décidé, en 2007, d’envoyer un livre toutes les deux semaines à Stephen Harper (101 lettres à un premier ministre, XYZ, 2011), le romancier Yann Martel disait vouloir, par ce geste, faire comprendre au premier ministre ce qui donne sens à la « civilisation canadienne », ce qui constitue les fondements de l’expérience humaine, bien avant le développement économique, qui ne devrait être considéré que comme un moyen au service d’une fin supérieure.
D’aucuns, à l’époque, ont raillé l’entreprise de Martel en qualifiant ce dernier d’artiste rêveur, niaisement étranger aux « vraies affaires ». L’écrivain avait pourtant un grand prédécesseur : John Maynard Keynes. Le plus célèbre économiste du XXe siècle a rêvé, sa vie durant, de voir s’effacer le « problème économique » afin que l’humanité puisse enfin se consacrer à « d’autres affaires d’une portée plus grande et plus permanente », comme les arts et la science, ainsi que l’explique l’économiste Ianik Marcil en préface à L’âge économique, un recueil d’essais de Claude Vaillancourt. « Dans ce futur radieux, continue Marcil, les économistes auraient donc un modeste rôle technique et n’occuperaient pas la place démesurée que ces spécialistes ont aujourd’hui dans l’espace public. »
Une dangereuse obsession
Romancier, professeur de littérature au collégial, président d’Attac-Québec (Association pour la taxation des transactions financières et pour l’aide aux citoyens) et collaborateur à la revue de gauche À bâbord !, Claude Vaillancourt fait le triste constat, dans L’âge économique, de l’échec du rêve keynésien. Dans notre monde, l’économie, qui devrait être une science modeste et « un aspect particulier de la politique ou de la vie en société », est devenue « une puissance, une force incontournable, une vérité indéniable à laquelle on doit tout sacrifier, la seule voie de la raison, une façon unique de penser, une logique froide et implacable qui guide les moindres décisions, un système qui s’applique désormais dans toutes les sphères de notre vie, une obsession ».
Pire encore, l’économie qui domine n’est pas la science en débat de l’art de gérer la richesse, mais la seule version dite néoclassique ou ultralibérale de cette science qui impose, résume Ianik Marcil, « la domination sans partage de la valeur commerciale » et « la prépondérance du calcul économique qui s’immisce dans toutes les sphères de notre vie ».
Les accords de commerce libre-échangistes donnent le pouvoir aux entreprises dans les relations internationales et, quant aux réglementations nationales, le monde de l’art est soumis à la logique marchande qui veut que « les films, la musique et les livres s’évaluent selon les ventes », l’univers scolaire subit d’incessantes évaluations de type managérial, « même la vie intime, l’amitié, les émotions et les idées doivent obéir à la loi des chiffres » sur les réseaux sociaux.
Au mépris des inégalités sociales qui grimpent et des inquiétudes environnementales, « l’enrichissement des individus, la consommation, l’exploitation des ressources naturelles et la croissance s’accomplissent de façon exponentielle dans une multiplication constante, sans que l’on envisage rien de sérieux pour stopper ce mouvement fou », se désole Vaillancourt.
> Lire la suite de l'article sur Le Devoir
Claude Vaillancourt contre la religion économique








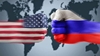























Laissez un commentaire Votre adresse courriel ne sera pas publiée.
Veuillez vous connecter afin de laisser un commentaire.
Aucun commentaire trouvé