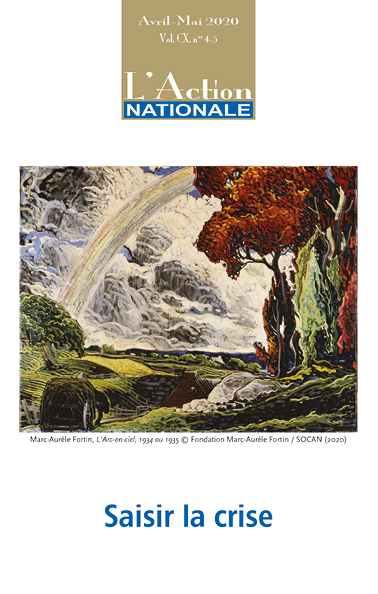À l’heure où la crise laisse voir non plus seulement des spectres, mais des ruines, qui voudrait croire qu’un virus apparu fortuitement ait pu ramener la province dans ce qu’elle a tant fait pour engourdir et ne pas voir ? Et c’est pourtant ce qui se dégage du portrait de ce qui nous attend. Le Québec paie le prix du déni de la crise de régime qu’il n’a pas voulu assumer et qu’il a tout fait pour occulter. La crise sanitaire a joué comme un révélateur, comme le font toutes les crises d’envergure. Il n’en tiendra qu’à nous, indépendantistes, d’en faire un catalyseur. Mais cela ne se fera pas par quelque vertu magique de la crise. Il n’y aura pas d’effet rédempteur à endurer toute cette souffrance. Il y aura le combat, il y aura l’abattement, il y aura le défaitisme et le goût de se soumettre. Bref, il y aura le Canada de toujours et les réflexes de minoritaires qui nous déformeront le regard et feront chanceler les consciences devant les chèques à l’unifolié et la suffisance d’un Trudeau et son engeance.
C’est un Québec mal en point qui s’est révélé, offrant un spectacle qui a vite fait de faire éclater la surprise première que la crise avait fait voir. Aux premiers jours du confinement, il y avait une fierté palpable à constater que nous étions encore capables de quelque chose, que nous pouvions vibrer et témoigner d’une cohésion nationale qu’un trop grand nombre considérait émoussée et faiblarde. La chose s’est imposée avec un étonnement d’autant plus bienfaisant que depuis vingt-cinq ans toutes les forces du régime canadian s’étaient mobilisé pour casser les ressorts de la nation. Le dénigrement systématique pratiqué par les libéraux provinciaux qui n’en finissaient plus de nous considérer comme un danger pour nous-mêmes, le climat dépresseur créé et entretenu qui a conduit au ras-le-bol et permis à la CAQ de se faufiler au pouvoir ne paraissaient plus qu’un mauvais souvenir. Aux premiers jours du confinement il y avait quelque chose de réconfortant à se sentir vivre.
Le Québec s’est construit dans l’adversité et il y a dans la culture des réflexes profonds qui ont resurgi avec force. Mais ce sont les réflexes développés devant l’adversité physique, matérielle, des réflexes qui nous ont rendu capables de composer avec l’hiver, avec l’indigence. C’est avec l’adversité politique, avec les manœuvres d’assujettissement que nous avons toujours eu du mal à composer. L’usure du confinement, l’accablement provoqué par le spectacle du désastre ont commencé de nous rattraper. Et de déclencher la sournoise mécanique de la condition minoritaire. Une mécanique que l’arrivée en force de l’État canadian a vite fait de replacer au centre de la situation. Et lentement le gouvernement Legault a recommencé à glisser et à s’enliser dans les ornières provinciales. De leader de notre gouvernement national, il est progressivement redevenu le gérant d’une agence de services brinquebalante que le désastre ramenait à sa vérité première : Ottawa apporterait le secours en ronchonnant discrètement sur l’incompétence de la province à apporter le soulagement. Insidieusement, sournoisement, les allusions et commentaires des politiciens, la condescendance des mandarins du Ottawa knows best ont commencé de saper la confiance. La fierté de se savoir capables a cédé le pas au doute. Et l’état des CHSLD a fini d’imposer le retour à la culture du dénigrement. La médiocrité et l’incompétence devenaient des thématiques omniprésentes pour instruire le procès des services publics, pour condamner les choix politiques et surtout, pour le faire en ne retenant que la gestion provinciale pour horizon. Les dégâts apparaissant dans les sphères de compétence du Québec, une armée de bonimenteurs s’est lancé sur la carcasse dans une surenchère d’anecdotes, de pseudo-analyses et de jugements péremptoires. Le Québec a vite été retourné à lui-même, c’est-à-dire au regard voilé qu’il porte sur sa propre condition.
Ottawa piétinait et piétine sans vergogne les « compétences provinciales », Trudeau plastronne avec fausse modestie, les choses se rangent lentement dans les catégories usuelles du dénigrement à bas bruit. La couleur du désastre redevient celle de l’impuissance et non pas de la dépossession. L’évidence que le Québec ne contrôle rien de l’arsenal des moyens essentiels ne s’impose pas. La crise a beau révélé le marasme, elle n’a pas encore déchiré le voile politique. La fatalité nous ramènerait à une impuissance sans cause, ou plutôt à une impotence première, inhérente. La province, le Québec n’aurait qu’à s’en prendre à lui-même, à ne s’expliquer que par ses insuffisances constitutives. À se voir devant un avenir sombre avec le doute et la crainte de manquer du nécessaire.
Ce que la crise donne à voir et que la conscience politique provinciale est incapable de discerner dans le paysage disloqué, c’est la rançon d’une défaite historique. Lancé dans la bataille référendaire de 1995 sans plan de repli stratégique, toujours intoxiqué par la candeur bonne-ententiste et le refus du combat, le gouvernement péquiste de l’époque a non seulement gaspillé la conjoncture, il a lui-même créé les conditions du dépeçage de notre demi-État provincial. Se refusant à nommer les choses par refus d’en assumer les conséquences, le péquisme bouchardien a intériorisé tous les paramètres de consentement à légitimer la riposte canadian. Ottawa qui n’a jamais rien eu d’un partenaire et tout d’un maître hypocrite et sournois n’en demandait pas tant. Il avait rigoureusement planifié une manœuvre de déstabilisation financière (calcul de la péréquation, réduction des transferts, réorientation des choix budgétaires pour assécher la province, etc.) et lancé un offensive juridique (Loi sur la clarté) doublée d’une gigantesque campagne de propagande axée sur la guerre psychologique, la destruction et le discrédit de la référence nationale québécoise, et voilà que le premier ministre de la province plutôt que de s’opposer pousse dans le sens du vent. L’austérité, l’équilibre des finances de la province allaient devenir un horizon. Le prophète s’est effondré. Le projet de pays s’est métamorphosé en plan comptable.
Réduction des effectifs dans la santé, répression brutale de la grève des infirmières, la liste commençait à peine. Plutôt que de radicaliser le procès du régime, le gouvernement Bouchard s’est retourné contre son propre peuple et a entrepris de le convaincre que la saine politique consistait à accepter de gérer le Québec avec les moyens que le Canada lui laisse. Dévastateur pour le mouvement souverainiste qu’il a mené à sa ruine, ce renoncement au combat a créé les conditions d’une déroute nationale que la pandémie a poussé à un degré qu’on ne croyait pas possible. Le réflexe politique du minoritaire a joué à fond : l’éternelle minimisation des pertes allait favoriser le rabougrissement résigné. Amorçant le long justificatif du « c’est ben d’valeur, mais on se reprendra », l’austérité bouchardienne allait produire un immense effet d’occultation. Se drapant dans un apparent sens des responsabilités, ce gouvernement a contribué plus que tout autre à masquer le fait fondamental de la condition politique à laquelle nous condamne le régime : dans le carcan fédéral le Québec n’a pas les moyens de son développement. En centrant l’attention et les débats sur l’équilibre des finances de la province, cette posture politique se faisait elle-même relais et condition d’efficacité de la stratégie fédérale.
Alors qu’Ottawa réduisait les transferts en santé, comble de l’ironie, Jean Charest faisait campagne et prenait le pouvoir en promettant de faire de la santé sa « première priorité ». Priorité au service de quel objectif ? Clairement, celui de soumettre la province. À la tête d’un gouvernement corrompu, l’envoyé d’Ottawa n’a rien négligé pour livrer la marchandise. Réforme de structures, manœuvre de neutralisation des institutions à portée nationale, l’approche a été systématique. Elle aurait été écrite ailleurs qu’il n’aurait pas mieux fait. Dualisation accrue du système de santé et d’éducation, traitement de faveur accordé aux institutions anglophones, complaisance devant les scandales financiers, rien n’y faisait. L’éternelle minimisation des pertes faisait le travail de consentement. Même les odeurs de pourriture n’ont pas suffi à sanctionner la clique d’inconditionnels du Canada. Il faut dire que l’appui d’un vote soviétique de la part de l’électorat anglicisé de Montréal et d’une portion significative d’électeurs répondant bien à la propagande fédérale ont joué un rôle au moins aussi grand que la maladresse d’un PQ qui achevait d’épuiser sa rhétorique.
L’ère Couillard allait ériger l’automutilation en idéal politique canadian. Un des plus puissants symboles de la manœuvre d’étouffement : le CUSM, ce méga centre inutile, haut lieu de la corruption. Le choix de forcer le partage des ressources à 50/50 ne faisait que pousser un cran plus loin la logique d’apartheid à laquelle la provincialisation conduit inévitablement. Les ressources qui ont manqué aux CHSLD, c’est là qu’elles se trouvent. Des milliards versés pour consacrer une hégémonie. Et dire que la province tout entière se perdait dans les débats sur les patates en poudre et les ablutions à la débarbouillette ! Gérant encore plus durement la province avec les moyens que le Canada lui laisse, le gouvernement Couillard, porté et enivré par le néolibéralisme triomphant qui lui faisait un formidable paravent, a accentué les distorsions en pratiquant une privatisation sauvage et d’autant plus agressive qu’elle servait d’instrument de clientélisme politique et de formidable alibi pour abrier la corruption. Il n’y avait pas de surprise à découvrir le passé trouble de généreux barons donateurs au PLQ propriétaires de résidences pour personnes âgées. Le saccage allait franchir un seuil inouï avec les choix du sinistre ministre Barette qui allait non seulement centraliser à outrance pour donner une poigne de fer à une machine bureaucratique qu’il avait mise à sa main à grand renfort de nominations partisanes, mais pousser à leur paroxysme les effets délétères d’un modèle technocratique déjà en crise.
Le gouvernement du ratatinement provincial est resté conséquent et parfaitement conforme à ce que la science politique enseigne des conduites des classes et groupes sociaux qui s’engraissent de la gestion de la dépendance. Les milliards ont coulé pour faire des médecins les plus gênants représentants de notre condition de provinciaux résignés. Et c’est sans parler des salaires indécents accordés aux détenteurs de sinécures. Et c’est sans parler non plus de la détérioration du système d’éducation, de la destruction de ce qui fut un formidable instrument d’émancipation et de lutte aux inégalités. C’est sans parler de, de et de…
On reste partagé devant l’énumération des scandales tant l’effet cumulatif ajoute au poids de la crise. Voilà plus de vingt ans que le Québec marine dans une torpeur mêlée d’insouciance parce qu’il n’a pas voulu prendre la mesure d’une défaite, parce qu’il n’a pas su orchestrer une riposte à une offensive fédérale d’une hostilité que trop de gens ne veulent pas voir. Le gouvernement Legault se trouve pris dans cette crise comme une mouche dans une toile d’araignée. Son électorat qui avait cru trouver dans son nationalisme bon enfant le reposoir que la violence symbolique de la guerre idéologique et le climat dépresseur monitoré avaient fait paraître si réconfortant, vient de se faire rappeler à la réalité.
Le débat public va être dur. Dur à mener, dur à subir. L’heure du bilan s’annonce à peine et le Canada ne manquera pas de faire ce qu’il a toujours fait : avancer le plus loin possible dans sa politique d’oblitération de notre peuple. Centralisation, chantage financier, condescendance idéologique et morgue dominatrice, tout cela n’empêchera pas le gouvernement Trudeau de voguer vers un mandat majoritaire. Et cela se fera sans doute avec l’appui d’une part non négligeable d’un électorat québécois plus que jamais convaincu que sans Ottawa la province ne peut se tirer d’affaire, inversant comme toujours les effets et les causes. Et cela ne manquera pas non plus de faire un espace confortable pour le discours austéritaire sur les finances de la province dont la crise aura révélé l’incompétence et la médiocrité. Le retour du même, en quelque sorte.
La crise ne portera pas de vertus salvatrices. C’est le combat politique qui peut seul en appeler et les traduire en politique réelle. Le redressement des finances, la lutte aux changements climatiques, le sauvetage des institutions culturelles, la sortie d’un modèle de développement extractiviste, la liste des thèmes sera interminable. La sortie de crise ne pourra se faire qu’en fonction de notre capacité à produire une politique conforme à notre intérêt national ou nous nous enliserons dans une minorisation accélérée et dans une médiocrité dont les premiers signes révélés par la crise ne sont rien en comparaison de ce qui s’annonce. Le Québec n’a pas les moyens d’être ce qu’il est et encore moins de ce qu’il pourrait être s’il n’apprend pas à se lire dans le réel, c’est-à-dire dans un régime qui ne lui fera pas de quartier.
La crise vient brutalement de nous rappeler à la Politique. Finies la petitesse politicienne et la partisanerie d’opérette. Nous voilà collectivement confrontés au dur désir de durer. Nous avons l’occasion de tremper le courage. Les mois qui viennent nous fourniront les occasions de recomposer les moyens que nous avions abandonnés dans la débâcle de 1995. En comprenant mieux et en reconnaissant les contraintes du régime et les pièges de la condition de minoritaire consentant, nous pourrons enfin combattre pour gagner, pour bâtir. Et nous bâtirons. Nous recommencerons jusqu’à aller au bout de nos forces. Avec la conviction que « ça ne pourra pas toujours ne pas arriver ».