*Recension de Chantal Delsol, Populisme : les demeurés de l’histoire, Paris, Éditions du Rocher, 2015, 267 p.
Le populisme est rarement, pour ne pas dire jamais, revendiqué. Il s’agit en fait d’une étiquette collée à un adversaire pour le stigmatiser et le discréditer. Associer un homme politique ou un parti au populisme, c’est chercher à le marquer au fer rouge. On les décrète infréquentables. Ce sont des dangers publics. Mais au-delà de l’injure, à quelle réalité ce terme réfère-t-il? Ou comme on dit aujourd’hui, de quoi le populisme est-il le nom? Car on le constate souvent: ceux qui hurlent au populisme sont généralement bien en peine de définir un tant soit peu rigoureusement ce qu’ils combattent et redoutent. Cette question, le politologue Vincent Coussedière l’avait brillamment exploré en 2012 dans son étonnant Éloge du populisme[1]. Elle est aujourd’hui reprise par Chantal Delsol, philosophe elle-aussi, qui mène dans Populisme : les demeurés de l'histoire son enquête en la commençant dans la Grèce antique pour la mener jusqu’aux querelles entourant le populisme européen contemporain.
Point de départ: la Grèce antique a inventé la démocratie mais ses philosophes se méfiaient du peuple. On l’assimile à la figure de l’idiotes, que les Anciens définissaient comme un homme incapable d’accéder au monde commun, trop campé sur sa propre vie, incapable de s’inscrire dans la cité, en quelque sorte. Les philosophes se méfiaient conséquemment de ceux qui s’appuyaient sur le peuple pour se hisser au pouvoir et qui le flattaient dans ses plus basses passions – car le peuple, on le sait, n’a que des basses passions! Cet intrus dans la cité, c’est évidemment la figure du démagogue. On préfère plutôt la figure du roi-philosophe, qui connaît le bien commun, qui en a, dirait-on aujourd’hui, une connaissance scientifique et qui gouvernerait les hommes du haut de sa supériorité.
Le seul à faire exception, vraiment, est Aristote, qui accordera au grand nombre une certaine sagesse et refusera de disqualifier à l’avance sa participation à la cité. Aristote, en quelque sorte, reconnaît au peuple une perspective légitime sur la cité – à travers lui, pour reprendre la formule de Delsol, les «lucidités s’additionnent» (p.29). Il n’y voit pas une bête inquiétante à dompter mais une partie du corps politique qui mérite d’être entendue. Cette perspective déplaît naturellement aux philosophes pour qui la politique n’est pas un art commandé par la prudence, mais une science de l’idée – on dirait aujourd’hui, qui dissout le politique dans l’idéologie. Aristote insiste: le peuple, quoi qu’on en pense, et même s’il n’est pas toujours absolument sophistiqué, a ses propres vertus. Chantal Delsol ne semble pas lui donner tort.
La question du populisme disparaîtra alors pour longtemps. «Entre l’antiquité démocratique et la période contemporaine, la figure du meneur de peuple occupe peu de place dans la réflexion politique» (p.57). Non pas que le peuple soit absent pendant deux mille ans – il se manifestera violemment ou non au fil des jacqueries et des révoltes qui marquent son histoire. Ce qui le distingue, bien souvent, c’est l’esprit de communauté. En général, il espère moins se gouverner lui-même qu’être bien gouverné. Mais la question du populisme en tant que tel ne peut vraiment se déployer que dans une société où on prétend fonder le pouvoir sur le peuple et où ce dernier, paradoxalement, se sent trahi par lui et la politique qu’il mène. En un mot, la question du populisme resurgira avec la prise de conscience de plus en plus vive des failles de la démocratie moderne.
Autour de quels enjeux émerge aujourd’hui la question du populisme? Qu’est-ce qui l’alimente? Pourquoi les peuples sentent-ils le besoin de marquer une dissidence de plus en plus clairement exprimée avec ce qu’ils croient être un système politique dans lequel ils ne se reconnaissent plus? Contre quoi souhaitent-ils se révolter en se tournant vers des formations politiques proscrites par le système médiatique, qui ne cesse de présenter leur émergence comme un danger pour la démocratie? On dit qu’il s’agit d’une politique d’opposition: mais à quoi le populisme contemporain s’oppose-t-il? À tout le moins, il faut prendre au sérieux les luttes idéologiques qui sont des luttes cherchant à définir la légitimité du pouvoir dans nos sociétés. La guerre des idées n'est pas une coquetterie d'intellectuels : elle délimite l'espace du pensable et conséquemment, du recevable et de l'irrecevable.
L’époque actuelle est commandée par l’idéologie de l’émancipation qui s’articule autour d’une «dogmatique universaliste» qui radicalise à outrance le projet des Lumières (p.97-124). Elle ne tolère plus pour l’homme contemporain quelque appartenance substantielle que ce soit – elle y voit immédiatement une prison dont il doit se délivrer. La communauté politique est vidée de toute charge existentielle, la nation passe pour ringarde, la famille étouffe la quête individuelle de chacun, l’école est accusée d’écraser la créativité et ne désire plus transmettre quelque héritage que ce soit. L’idéal contemporain, c’est l’homme nu, à l’identité insaisissable, ne se liant aux autres que selon ses propres termes, pour mieux s’en délier ensuite. C’est ainsi qu’il entend se délivrer de tout, tenté qu’il est par le fantasme de son autoengendrement.
Chantal Delsol note très justement que l’idéologie de l’émancipation «attire tout vers elle de façon irrésistible, et presque sans convaincre» (p.202). Elle traduit toute la réalité dans son discours, et assimile ce qui lui résiste à des structures discriminatoires qu’il faudra tôt ou tard déconstruire, pour qu’advienne le monde de l’individu absolu. Tel est le programme politique de notre époque, et elle s’impose à la fois au système médiatique et aux partis qui espèrent être bien vus et obtenir le pouvoir. Ce programme, il se mène évidemment au nom des droits de l’homme, dont l’empire ne cesse de s’étendre, comme si chaque désir se laissait convertir en besoin et chaque besoin en droit. Et dans cette marche vers la désincarnation, qui relève en fait d’une véritable conversion anthropologique, il y a toujours encore beaucoup de chemin à faire.
Cette idéologie est portée par des élites mondialisées, comme l’avait déjà noté Christopher Lasch[2], qui souhaitent pouvoir s’installer dans n’importe quel pays et se sentir immédiatement chez elles – ce qui implique d’uniformiser la planète, de l’aménager de telle manière que d’un pays à l’autre, les cultures ne soient plus des obstacles à la citoyenneté globale mais, au mieux, des résidus de préjugés vers lesquels pourront se tourner les pauvres d’esprit, qui ont besoin d’un cocon identitaire où se réchauffer. Celui qui se laisse charmer par le populisme n’est-il pas un idiot, un demeuré, un imbécile? Delsol nous dit que «celui qui se met en travers du chemin ne combat pas un adversaire commun, un homme, une pensée, une armée : il récuse le destin lui-même, il blesse l’histoire, il injurie le temps» (p.104). Qui s’oppose au progrès ou à ce qu’on fait passer pour tel se met consciemment hors l’humanité et ne saurait demander à ce qu’on l’entende dans la cité. C’est ainsi que la postmodernité redécouvre sans la nommer la figure de l’ostracisme.
L’idéologie de l’émancipation, nous dit Delsol, s’accompagne presque automatiquement aujourd’hui de la haine du peuple qui empêche de moderniser en rond en s’entêtant à valoriser son héritage et qui vit très mal le déracinement sauvage qu’on lui inflige. Car l’homme, nous dit Delsol, a besoin d’ancrages et cherche à le faire savoir politiquement. Le populisme contemporain n’est pas qu’un style politique, même s’il est presque inévitablement gouailleur. En fait, le populisme contemporain est d’abord un conservatisme ou, si on préfère, une politique du particularisme historique. Pour reprendre les termes exacts de la philosophe, «le populisme exprime, dans la plupart des cas, de façon erratique et violente, un conservatisme qui ne parvient pas à se faire de façon cohérente dans les lieux officiels» (p.110). Il incarne une défense des ancrages dans un monde poussé violemment vers un universalisme si radical qu’il représente une déshumanisation pour l’homme – et on pourrait voir cela à l’œuvre à la fois dans la judiciarisation du politique tout comme dans sa dissolution gestionnaire.
Les peuples cherchent à conserver leurs coutumes, leur mémoire, leur identité – leur monde commun, dirait Alain Finkielkraut. Bien sûr, ils risquent alors de les fossiliser. Mais on aurait d’y voir une fatalité – le souci de la durée, de la «continuité historique», pour reprendre les mots de Bénérice Lévet, est honorable[3]. À la différence des élites mondialisées qui voient dans chaque limite un obstacle à abattre, le peuple y voit des repères à préserver. Il n’a toujours pas accepté la privatisation de la culture et du sens. Et c’est justement autour de ces préoccupations interdites que se déploient les partis populistes, en réhabilitant notamment les exigences liées à la patrie, qu’il s’agisse de défendre sa souveraineté on son identité. Ils repèrent certainement une niche électorale: ils répondent néanmoins à une demande politique, et plus encore, à une demande de sens historique. Et on ne saurait toujours rabattre leur croissance sur un éternel retour des années 1930, comme si toute pensée du particularisme ou de l’autorité devait fatalement s’y rabattre.
Si le nazisme représentera à jamais l’horreur absolue d’une politique poussant si loin la séparation entre les hommes qu’elle en exclut de l’humanité par millions, on ne saurait non plus rabattre toute conception substantielle de la nation sur l’entreprise meurtrière hitlérienne. Et quoi qu’on pense des populismes européens, on ne saurait sérieusement en faire une résurgence du fascisme ou du nazisme. D’ailleurs, des hommes comme Churchill et de Gaulle, qui ont joué un si grand rôle dans la lutte contre l’hitlérisme, n’étaient pas exactement des droits-de-l’hommistes au sens où on entend ce terme aujourd’hui. C’est au nom d’un patriotisme charnel, enraciné, vivant, historique, et souvent même mystique qu’on entrait en résistance contre le nazisme, comme l’a déjà noté Maxime Tandonnet dans un ouvrage sur la génération de 1940[4]. Il fallait avoir la foi en sa patrie et en sa civilisation – et qui sait, peut-être même en Dieu![5]- pour poursuivre la guerre après l’effondrement du mois de juin 1940.
De même, et pour rester dans cet esprit, contre le communisme, en Europe de l’est, les identités nationales et religieuses étaient conservatrices de la liberté politique – elles représentaient une source de sens où puiser contre un régime qui programmait la déculturation des peuples. Je note au passage une réflexion en ce sens de Régis Debray qui dans Un candide à sa fenêtre, confesse redécouvrir «le rôle crucial qu’a joué la croyance religieuse dans l’incroyable résistance physique et morale des Polonais au nazisme » et qui ajoute qu’on «frémit en pensant aux effets moraux et physiologiques de la déchristianisation de l’Europe sur nos capacités de résistance»[6]. La figure de Soljenitsyne, d’ailleurs, qui représente la résistance de la Russie devant le communisme n’est pas exactement conforme aux prescriptions de l’athéisme matérialiste – lorsqu’ils l’ont découvert, les Occidentaux ne lui ont pas pardonné, d’ailleurs[7].
Quoi qu’il en soit, à travers les enjeux soulevés pour le meilleur et pour le pire par le populisme tel que se le représente Chantal Delsol, nous sommes au cœur du clivage majeur de notre temps qui va bien au-delà de la petite querelle entre la gauche sociale-libérale et la droite libérale-sociale. Il se formule philosophiquement et anthropologiquement, entre ceux qui rêvent à l’illimité, et ceux qui ont le sens des limites. Il se formule politiquement entre ceux qui entendent déconstruire tout ce qui entrave la naissance d’un nouvel homme nouveau, d’un individu absolu, autocréé, autoengendré, en quelque sorte, et ceux qui entendent aussi appliquer le principe de précaution aux choses humaines, en préservant les institutions civilisatrices et les cadres formateurs de l’existence humaine – la table rase fait le lit de toutes les barbaries. Et la querelle entre le progressisme et le conservatisme recoupe aujourd’hui aussi en bonne partie une nouvelle lutte de classes, d’ailleurs, dont Marcel Gauchet avait déjà repéré à sa manière le retour dès 1990[8], au moment même où on décrétait sa disparition définitive. La fiction libérale d’une société seulement définie par la libre concurrence et coopération des individus ne saurait durablement occulter. La fin de l’histoire n’est pas pour demain.
Faut-il le dire, on devient aisément conservateur, et même réactionnaire, dans un monde voué au mouvement perpétuel. On le devient presque malgré soi. On connait tous un de ces hommes de gauche, ou du moins, qui se veut encore de gauche (en fait, il tient beaucoup à ce qu’on le dise de gauche et ne cessera de se lamenter en se demandant ce qu’est la gauche devenue), mais qui entend demeurer fidèle à l’humanisme scolaire, à la souveraineté nationale ou qui critique vertement le multiculturalisme. La scène est presque comique: il cherchera alors à rappeler qu’il est de gauche même s’il se sent de plus en plus conservateur et ses anciens camarades, qui ont suivi la marche du progressisme (par exemple en passant du socialisme au multiculturalisme, et en troquant la référence à l’ouvrier pour la référence au minoritaire) se désoleront alors de lui en disant qu’il est passé à droite, ce qui ne se pardonne pas, alors qu’il se sera contenté de demeurer fidèle à ses convictions de toujours, conjuguant honorablement souci de la nation et quête de la justice sociale. Il se dira même conservateur de gauche, car étonnamment, il lui sera moins pénible d’être à sa manière conservateur que de «passer à droite», comme s’il s’agissait alors d’une suprême trahison, d’un passage dans le camp ennemi.
On pourrait presque en faire une loi politologique. Il suffit de ne pas suivre le rythme et de se montrer un peu plus attaché que prévu à certaines institutions, à certaines traditions, à un mode de vie, à un cadre politique et on est immédiatement associé à la droite, et tôt ou tard, à la droite populiste, et pour finir à l’extrême-droite. La logique est implacable: le centre-droit d’hier deviendra la droite d’aujourd’hui et la droite populiste de demain. Les hommes politiques comme les intellectuels redoutent cela plus que tout, et conséquemment, ils ne cessent de donner des gages à l’idéologie progressiste pour éviter de devenir infréquentables malgré eux. L’histoire française, depuis les années 1980, est exemplaire de ce reniement du conservatisme par la droite, qui en vient à se rêver plus progressiste et plus moderne que la gauche, comme l’a déjà noté Éric Branca dans son admirable Roman de la droite[9]. Évidemment, le système médiatique devient fou et hurle au dérapage lorsqu’une figure majeure devient indifférente au fait d’être bien vue par l’idéologie dominante: il ne tolère pas qu’on s’affranchisse de son système de respectabilisation.
Le grand clivage de notre temps est donc posé: faut-il dès lors trancher entre l’universel et l’enracinement, en prenant son camp dans une lutte à finir? Faut-il embrasser pleinement une cause et souhaiter l’échec définitif de l’autre? Certainement pas. L’essentiel, selon Delsol, ne consiste pas à donner raison à un des deux partis, car l’humanité a besoin à la fois de l’émancipation et de l’enracinement. On trouve là deux nécessités existentielles, qui trouvent un écho dans le cœur de l’homme, et auxquelles répondent des tempéraments différents dans chaque société. En séparant les deux, elle se condamne soit au décharnement, soit à l’étouffement. Mais elle ne se contente pas de ce nécessaire appel à l’équilibre. On pourrait dire qu’en chaque démocratie, il faut à la fois un parti du mouvement et un parti de la conservation, ou si on préfère, un parti de la rupture et un parti de la durée. Lorsqu’un des deux pôles devient intolérant au point de nier à l’autre le droit d’exister, en ne le définissant plus que par l’injure et la calomnie, c’est la démocratie qui devient claudicante.
Chantal Delsol n’accompagne pas son ouvrage d’un «que faire». Elle entend davantage faire comprendre que donner des leçons. Néanmoins, elle n’hésite pas à dire que l’urgence, aujourd’hui, est à l’éducation des élites, à leur «désidéologisation» (p.257). L’élite qui se pique d’ouverture devrait s’ouvrir au peuple, en laissant de côté ses préjugés contre lui et contre l’enracinement. Plutôt que de maudire le peuple, ne devrait-elle pas chercher à comprendre les raisons de sa dissidence sans le diaboliser de quelque manière que ce soit? Naturellement, le peuple, s’il est en droit de valoriser son héritage, ne devrait pas se fermer à l’idéal d’universalité, qui demeure une idée régulatrice pour l’humanité. Mais les torts ne sont pas également répartis, et dans les circonstances actuelles, il convient de s’intéresser au malaise du peuple sans se sentir obligé de l’accabler d’insultes en le croyant pris de convulsions phobiques devant la diversité – la psychiatrisation de la dissidence est vraiment une des plaies de la démocratie contemporaine.
Au fil des ans, Chantal Delsol a construit une œuvre majeure[10]. C’est celle d’une philosophe qui enquête sur notre modernité tardive sans se lancer dans une polémique abrasive mais sans faire de lâches concessions à l’esprit du temps. On la traversera passionnément. Son livre sur le populisme vient en quelque sorte concrétiser cette enquête en la transposant directement dans le domaine politique. Que faire devant la protestation non plus seulement philosophique mais politique contre la modernité radicale ? Chantal Delsol, ici, réhabilite ce qu’elle croit être la part noble du populisme contemporain. Non pas qu’elle revendique l’étiquette pour elle-même et d’ailleurs, elle sait se montrer fort critique à son endroit. Elle ne laisse à aucun moment croire qu’elle y voit la mouvance susceptible de régénérer la démocratie. Elle n’idéalise pas l’objet de sa recherche: elle se contente de le traiter honnêtement.
Mais dans la mesure où le phénomène populiste marque la politique européenne contemporaine, elle entend dissiper l’odeur de soufre qui l’entoure, comme s’il fallait obligatoirement s’avancer devant lui avec un pince-nez. En fait, elle souhaite surtout le réintégrer dans la vie politique, pour qu’il ne serve plus de repoussoir absolu, à la manière de l’ennemi détestable contre lequel mener une croisade, ce qui contribue à embellir par effet de contrastes des forces politiques officielles historiquement épuisées et en état de mort cérébrale. La première chose à faire ne serait-elle pas de renoncer à ce vocable en évitant de pathologiser le conservatisme? D’ailleurs, elle le suggère clairement: lorsqu’un pays assume son histoire et n’est pas saisi de l’ivresse du néant, le populisme ne parvient pas à y prospérer.
Chose certaine, son ouvrage désembrouille l’espace public et nous permet de mieux comprendre ce que nous nommons si mal.
[3] Bérénice Levet, «Le droit à la continuité historique», Le Débat, no177, novembre-décembre 2013, p.14-22.
[5] À ce sujet, on lira le livre magnifique de Gérard Bardy, Les moines-soldats du général, Paris, Plon, 2012.
[7] À propos de Soljenitsyne, on lira l’ouvrage exceptionnel de Daniel Mahoney, Alexandre Soljénitsyne : en finir avec l’idéologie, Paris, Fayard, 2008.
[8] On consultera à ce sujet son article « Les mauvaises surprises d’une oubliée » recueilli dans Marcel Gauchet, La démocratie contre elle-même, Paris, Gallimard, 2002, p.207-228.
[10] J’évoque ici seulement certains titres, en prenant la peine de dire qu’on pourrait en mentionner bien d’autres : Chantal Delsol, Le souci contemporain, Paris, Complexe, 1996; Chantal Delsol, La grande méprise, Paris, La table ronde, 2004; Chantal Delsol, Qu’est-ce que l’homme ? Paris, Éditions du Cerf, 2008 ; Chantal Delsol, L’âge du renoncement, Paris, Éditions du Cerf, 2011 ; Chantal Delsol, Les pierres d’angle, Paris, Éditions du Cerf, 2014 ;
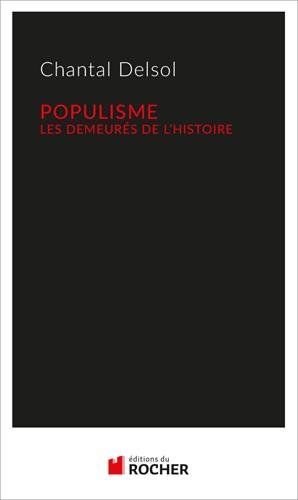





















Laissez un commentaire Votre adresse courriel ne sera pas publiée.
Veuillez vous connecter afin de laisser un commentaire.
Aucun commentaire trouvé