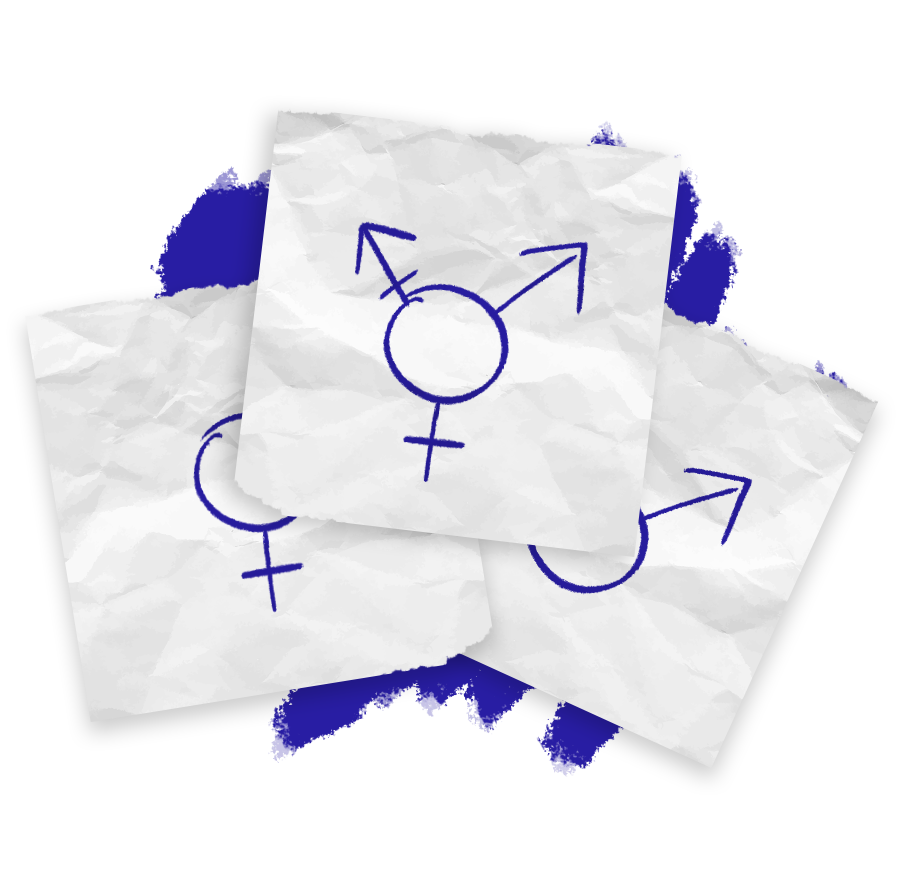À l'adolescence, ils désiraient plus que tout changer de sexe. Ils ont commencé le processus, mais en cours de route, certains se sont rendu compte qu'ils ne l'avaient pas fait pour les bonnes raisons et sont retournés à leur sexe d'origine. Leurs témoignages se multiplient sur la toile. Ils s'appellent eux-mêmes les « détransitionneurs ». Regard sur un phénomène récent, marginal, mais qui se manifeste partout en Occident.
J’ai commencé à me questionner sur mon genre. Suis-je une fille, un gars, entre les deux? Qui suis-je? C’est la question que tu te poses souvent en tant qu’ado.
Clara, 14 ans, aime la littérature, les magazines, les mots. Je lui ai donc proposé tout d’abord de m’écrire une lettre pour me raconter son histoire.
Quand je l’ai reçue dans ma boîte de courrier électronique, il y avait ceci dans l’objet :
Je pensais que j’étais trans.
Un titre au passé donc.
Comme Clara, Jay, Jesse, Helena, Dagne ou Eva Michelle parlent aussi au passé lorsqu’ils évoquent leur « période » transgenre. Tous et toutes m’ont raconté avoir voulu changer de genre à l’adolescence avant de reculer, parfois tôt, parfois tard. C’est une réalité nouvelle pour la science et la majorité des spécialistes sont très perplexes vis-à-vis de ces cas. Étaient-ils au départ véritablement de jeunes transgenres? Qui sont-ils? Pourquoi ont-ils voulu changer de sexe? Constituent-ils une marge d’erreur dans notre nouvelle façon de traiter les jeunes personnes transgenres?
Clara
Pendant des mois, Clara est obsédée par la question de son genre : garçon ou fille? Puis une vérité s’impose à son esprit. Elle ne se sent pas très « fille », alors elle sera un garçon. Elle est un garçon. Et ses parents l’appuient.
Sa mère, une femme dynamique, ouverte d’esprit, lui procure un binder(une sorte de corset) conçu pour lui cacher les seins. Elle lui achète des vêtements de garçon. Et, bien sûr, elle et son ex-mari avertissent l’école, qui, sans hésiter, change son nom pour celui choisi de Franck. Les professeurs suivent, les élèves se réjouissent, la transition se passe bien. Et sa maman peut alors pousser un grand soupir de soulagement.
« Sur tous les sites que je consultais, il était écrit que les enfants trans qui sont rejetés vivent de la détresse, m’a-t-elle dit. Je ne voulais pas cela. Quand tu es parent, ce qui compte, c’est que ton enfant soit heureux. »
Peu après avoir ouvertement affiché son identité trans, Franck obtient un rendez-vous dans une clinique pédiatrique montréalaise où sont dirigés la majorité des mineurs qui vivent un malaise avec leur genre au Québec.
Franck a alors 13 ans. Il souhaite se faire enlever les seins et prendre de la testostérone. Il en parle beaucoup. Il en rêve, se projette. « Je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube de transition et ça m’inspirait. »
Or, lorsque l’endocrinologue lui suggère des bloqueurs de puberté, soit des inhibiteurs d'hormones, il se montre craintif. Le médecin, patient, lui suggère de prendre son temps; il l’attendra.
Franck et ses parents y retourneront trois fois, et chaque fois, Franck tergiverse.
« J’essayais très fort de me conformer à la nouvelle étiquette que je m’étais donnée. J’ai essayé d’agir d’une façon plus masculine. J’ai essayé d’oublier mon côté féminin, de m’oublier moi, et ça ne marchait pas du tout. Je gardais un sourire de façade, mais je n’allais pas bien. Je me suis rendu compte que, finalement, je n’étais pas transgenre, mais tout simplement lesbienne. »
Non pas Franck, mais Clara.
« Ma famille le sait, mes trois amies les plus proches le savent. À part de ça, personne ne le sait encore et il faudra que je sorte du placard, encore. Ça me fait vraiment peur, je n’ai vraiment pas le goût de le faire, mais je sais qu’il faudra que je le fasse à un moment donné. Merci d’avoir lu! »
En Occident, les jeunes qui désirent changer de sexe sont de plus en plus nombreux. Ceux qui passent à l’acte aussi, comme en témoigne la multiplication de témoignages de jeunes sur les réseaux sociaux qui documentent leurs transitions vers l’autre sexe. Y a-t-il plus de jeunes transgenres? Non, disent des voix de tous les horizons, c’est une simple correction historique attribuable à l’évolution de nos sociétés sur le sujet. Après avoir vécu dans la noirceur d’une discrimination intense, notamment de la part des psychiatres, les tabous tombent et les soins sont plus accessibles, bien que ce soit encore difficile.
À 58 ans, Michelle Blanc est sans doute l’une des femmes transgenres les plus connues au Québec. Elle a dû attendre l’âge de 46 ans avant de pouvoir faire une transition. « Pourtant, je savais que j’étais une femme depuis l’âge de 3 ans. » À son avis, l’accès aux soins pour les jeunes, c’est une question de vie ou de mort. « Le taux de suicide chez les jeunes trans est très élevé et ces traitements permettent de sauver des vies », soutient-elle.
Partout dans le monde, on constate également que, depuis quelques années, le ratio de jeunes filles qui veulent devenir des garçons est désormais plus élevé que l’inverse. Au Centre d’orientation sexuelle de l’Université McGill, le Dr Richard Montoro constate, lui aussi, que la proportion hommes-femmes de sa clientèle a beaucoup changé dans les dernières années. « Avant, c’était deux gars pour une fille. Maintenant, c’est l’inverse », dit-il.
Un autre tout nouveau phénomène encore peu documenté, bien que présent sur les réseaux sociaux, est celui des « désisteurs » et des « détransitionneurs » qui s’ajoute à ce tableau complexe.
Les mots sont nouveaux, tout comme la réalité qu’ils désignent. Leur nombre n’est pas encore connu. Le Dr Montoro avance le chiffre de 2 % à 5 %, alors que d’autres nuancent. « Aucune recherche ne permet de dire combien il y en a », soutient Dre Susan Bradley, une sommité dans le domaine. Mais on connaît leurs noms, ou plutôt le plus souvent leurs pseudos, car leur existence cause un immense malaise. Sur les réseaux sociaux, dans de nombreux groupes de discussions, ces « détransitionneurs » qui s’affichent de plus en plus aimeraient bien pouvoir parler de leur souffrance, de leurs parcours difficiles.
« Je ne suis pas une fille-fille »
Clara m’a écrit. Nous nous sommes parlé au téléphone, puis je l’ai rencontrée, elle et ses parents.
- Pourquoi pensais-tu être un garçon?
Clara rit. Du rire léger des adolescents.
Je ne sais pas vraiment. Je suivais une lesbienne sur YouTube qui est devenue un homme trans. Et je me suis mise à me poser des questions.
- Comment te sentais-tu en garçon?
Elle rit.
- Je ne sais pas. J’avais l’impression que je n’étais pas une fille, le genre de fille qui s’épile et qui aime le maquillage. Une « fille-fille » comme sur Instagram, genre! Donc, je me suis dit que j’étais un gars...
Clara marque une pause. Ses parents et moi ne comblons pas le silence. Elle reprend la parole.
- Quand j’y repense, ça me donnait aussi un sentiment d’appartenance. C’est très l’fun. Quand tu fais ton coming out, tu as full de support. Les autres trans sur Internet te disent : « Bravo, on est avec toi. » J’aimais ça, ce côté-là, appartenir à un mouvement, parce qu’à l’école, ce n’est pas si facile d’avoir un sentiment d’appartenance.
- Et aujourd’hui?
- Je me sens mieux dans ma peau depuis que je suis redevenue une fille. La seule chose qui me fait peur, c’est de devoir le dire à l’école.
Devenir qui je suis
En Angleterre, le nombre de jeunes qui frappent à la porte des cliniques d’identité de genre a quadruplé en 5 ans. 70 % de ces jeunes étaient de sexe féminin à la naissance. Aux États-Unis, le nombre de ceux qui s’identifient comme des personnes trans a doublé en 10 ans. En Australie, à l’hôpital de Victoria, la clientèle a augmenté de 200 % en 10 ans.
Le phénomène est similaire au Canada. Par exemple, début mars, le Centre hospitalier pour enfants de l'Est de l'Ontario à Ottawa affirmait avoir accueilli 189 patients en 2018, contre seulement deux il y a 10 ans.
« Je ne peux pas vous donner de chiffres absolus, mais en 2011, notre liste d’attente était de 4 à 6 semaines. Aujourd’hui, elle est de 6 à 8 mois », m’a dit le Dr Richard Montoro, psychiatre et cofondateur du Centre d’orientation sexuelle de l’Université McGill.
De plus en plus de spécialistes et acteurs importants du domaine plaident pour que l’âge des traitements soit abaissé dans la prochaine édition des Standards de soins de la WPATH, l’Association professionnelle mondiale pour la santé des personnes transgenres, qui fait autorité dans le domaine de la transition médicale et agit pour promouvoir les droits des personnes trans.
La pratique au Québec repose aussi sur ces Standards de soins. « Les conduites cliniques en matière de soins aux personnes trans sont arrimées avec le référentiel de la WPATH », nous a répondu le service des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux.
Actuellement, ces Standards de soins recommandent un traitement par étapes chez les jeunes. D’abord, la prise de bloqueurs de puberté au début de l’adolescence pour éviter le développement de caractéristiques sexuelles non désirées. On conseille de passer à l’étape suivante : soit la prise d’hormones du sexe désiré. On recommande d’attendre la majorité pour la chirurgie.
En Californie, Johanna Olson-Kennedy, directrice d’une des plus importantes cliniques pour jeunes transgenres aux États-Unis, le Center for Transyouth and Development de l’hôpital de Los Angeles, vient de publier une étude proposant d’abaisser l’âge pour l’ablation des seins, ce qui permettrait de réduire la « dysphorie de poitrine ».
« Les recommandations pour des interventions chirurgicales devraient se baser sur les besoins de l’individu plutôt que sur l’âge », écrit cette scientifique qui a reçu une subvention de près de 6 millions de dollars de l’Institut de la santé américaine (NIH) pour étudier l’impact de traitements beaucoup plus précoces sur quelques centaines d’enfants. Dans ce protocole, on vient d’abaisser l’âge pour les traitements de 13 ans à 8 ans.
Lors d’une conférence, la pédiatre a par ailleurs déclaré que la possibilité qu’un jeune change d’idée ne devait pas constituer un frein à des interventions chirurgicales sur les mineurs, en évoquant les doubles mastectomies de deux transgenres de 13 ans qui avaient été bénéfiques pour leur santé mentale.
« S’ils le regrettent, ils pourront se faire reconstruire des seins plus tard! »
– Extrait de sa conférence
Trop tard ou trop tôt?
Quand agir? À quelle vitesse? Si certains disent qu’il faut le faire le plus tôt possible pour éviter aux jeunes plus de souffrances, d’autres spécialistes commencent à dire qu’il faut à tout prix éviter la précipitation.
En janvier 2019, la revue scientifique Clinical Child Psychology and Psychiatry publiait une étude portant sur des cas semblables à celui de Clara, qui font volte-face.
Les auteurs travaillent au Tavistock and Portman NHS Foundation Trust, où se trouve la plus importante clinique de genre destinée aux mineurs au Royaume-Uni. En 10 ans, le nombre de jeunes ayant frappé à leur porte est passé de 97 à près de 2600 par année.
Ces jeunes ressentent une dysphorie de genre, un mal-être face au sexe biologique. Dysphorie de genre est l’expression consacrée dans le domaine pour définir la discordance ressentie entre le sexe attribué à la naissance et le genre.
Les auteurs de l’étude ont remarqué qu’un nombre croissant de jeunes présentant à l’origine toutes les caractéristiques d’une dysphorie de genre et qui demandaient une intervention médicale ont changé d’idée au fil des rencontres à la clinique. Les chercheurs concluent donc qu’il serait avisé de prendre plus de temps pour évaluer avant de prescrire.
Or, la WPATH ne recommande pas un nombre minimum de rencontres avant de commencer des traitements de nature médicale.
« D’abord, un nombre minimum de séances peut créer des barrières et décourager une réelle opportunité d’évolution personnelle. Deuxièmement, les professionnels en santé mentale peuvent proposer un soutien important aux clients tout au long des phases d’exploration de l’identité de genre et de l’expression de genre, et de la possible transition », peut-on lire dans les Standards de soins de la WPATH.
Le Dr Shuvo Ghosh, responsable de la clinique pédiatrique Meraki (affiliée au CUSM), la référence dans le domaine à Montréal, nous a précisé ceci par courrier électronique.
« Il n'y a pas de “minimum” ni de maximum de rencontres. Néanmoins, [...] on ne commence pas le processus si nous n'avons pas assez d'informations cliniques et que le patient n'éprouve pas une discordance importante entre son sexe et son genre. Il est aussi important d’identifier les jeunes patients qui n'ont pas besoin d'une future transition médicale [...] Notre approche se soucie de prévenir les possibilités d’erreur, au mieux de nos capacités. »
Un mal-être apparu à l’adolescence
Le papa de Florence est un artiste, de gauche, qui habite à Montréal. À 14 ans, sa fille lui annonce être un garçon. Son amie d’enfance vient de faire la même chose.
Ce sera donc Florent.
« Je suis et je demeure très perplexe par rapport à ça », me confie son père. « Il n’y a jamais eu de manifestation de cela dans son enfance. Il est suivi par une psychologue depuis longtemps parce qu’il est très anxieux. Sa psy n’a jamais vu de signes de dysphorie de genre. »
« Quand il me parle de ça, il se dégage comme une impression de fausseté, j’ai le sentiment de parler à une page Wikipédia. Le décloisonnement des genres, c’est formidable, insiste-t-il, mais là, ironiquement, j’ai l’impression d’être au contraire face à un hypergenrisme. »
Néanmoins, Florent est accepté par ses parents. Son nom a été changé à l’école et, rapidement, un rendez-vous est pris à la clinique de Montréal, la même que celle fréquentée par Clara.
« Après 20 minutes, une endocrinologue lui a prescrit des bloqueurs de puberté », me dit son père. « C’est seulement après qu’elle ait eu sa prescription que nous avons rencontré un psy. »
« La souffrance est réelle, dit la mère de Florent, mais j’aimerais bien qu’on fouille un peu du côté psychologique avant de prescrire et de changer son corps, au lieu d’affirmer tout de suite son désir de changer de sexe. »
Elle est tout aussi mal à l’aise avec la pression sociale, qui laisse peu de place au doute. « Si on doute, on est automatiquement anti-trans, et remettre la transition médicale en question, c’est perçu comme être en faveur d’une thérapie de conversion pour les homosexuels digne des pires obscurantismes. »
Une réalité vécue de la même façon à des milliers de kilomètres de Montréal.
« Moi, je suis juive et j’ai passé ma jeunesse en Israël, mais lorsque je critiquais la politique d’Israël par rapport à la Palestine, je me faisais traiter d’antisémite », explique Brie Jontry, mère d’une détransitionneuse qui vit au Nouveau-Mexique.
« Transphobe, c’est un peu la même chose. Tu ne veux pas être transphobe comme personne ne veut être accusé d’antisémitisme. Or, on peut critiquer Israël sans être antisémite… vous voyez ce que je veux dire? »
Brie, une universitaire de gauche, est la porte-parole d’un site de parents d’enfants trans où toutes les questions sont les bienvenues. The 4thwavenow est visité par 60 000 à 70 000 personnes par mois.
Brie Jontry consacre à ce site, beaucoup de temps et d’énergie, sa propre expérience l’ayant beaucoup marquée. « Il faut qu’il y ait de la place pour une discussion sereine », dit-elle.
Elle et son ex-mari avaient accepté sans problème l’affirmation de leur fille de 11 ans lorsqu’elle leur a dit qu’elle était un garçon. Des mois plus tard, alors qu’aux nouvelles, on discute de la déclaration de Donald Trump « Just grab them by the pussy », l’adolescente déclare à sa mère :
« Tu vois, c’est pour ça que je ne voulais pas être une femme, c’est incroyable comment on traite les femmes dans notre société! »
« Je lui ai demandé pourquoi elle parlait au passé », me raconte Brie Jontry de son appartement au Nouveau-Mexique. « Elle m’a dit qu’elle ne se sentait pas vraiment comme un gars, mais qu’elle trouvait que le monde était bien hostile aux femmes et qu’elle a pensé que ce serait mieux alors d’être un gars. Tout cela est si complexe. »
La puberté, une horloge biologique bien embêtante
La question des bloqueurs de puberté mérite qu’on s’y arrête.
« En moyenne, explique le Dr Montoro, on peut prescrire ces bloqueurs dès l’âge de 11 ou 12 ans pour les filles et de 13 à 14 ans pour les garçons », soit avant de passer aux hormones vers 16 ans, sinon un peu avant. « Les bloqueurs de puberté, ça permet de gagner du temps, que le jeune ne passe pas par la mauvaise puberté. [...] C’est alors plus facile après de faire une transition », dit le spécialiste.
Oui, ils réduisent l’anxiété, « comme des antidépresseurs », a-t-on dit aux parents de Florent, mais ont-ils des effets secondaires à moyen et à long terme? L’état actuel de la recherche ne nous permet pas de le dire. À la clinique visitée par Florent, on compare leur prise à celle de la pilule anticonceptionnelle.
La WPATH stipule aussi que, d’une part, les bloqueurs permettent de suspendre le développement des caractéristiques sexuelles non désirées, donc de réduire le mal-être, la dysphorie, mais écrit : « De l’autre côté, il y a des problèmes liés aux effets physiques négatifs de l’utilisation des analogues de la GnRH (ex : développement du squelette et de la taille). »
En janvier dernier, la célèbre émission de journalisme d’enquête de la BBC, Panorama, abordait la question. Le directeur de l’Institut de recherche sur les données probantes en médecine de l’Université Oxford, Carl Heneghan, a révisé l’ensemble de la recherche la plus récente sur la question et a déclaré qu’il était impossible de demander aux patients un consentement éclairé au moment de leur offrir ces bloqueurs, comme on le fait actuellement dans les cliniques.
« Est-ce que les patients peuvent prendre une décision basée sur des données probantes? La réponse est non! La science nous permet pour l’instant d’affirmer bien peu de choses sur les bloqueurs de puberté, sinon qu’ils la bloquent. »
– Dr Carl Heneghan, de l’Université Oxford
Une étude publiée par des chercheurs de la clinique de genre du Lurie Children’s hospital à Chicago mentionne que la prise d’inhibiteurs d’hormones suivie par la prise d’hormones de l’autre sexe peut aussi entraîner l’infertilité.
D’ailleurs, certains chercheurs croient qu’il faut abaisser l’âge minimum des traitements chirurgicaux, justement parce que les organes visés seraient déjà non fonctionnels suite à la prise de bloqueurs, puis d’hormones du sexe opposé. « Si on a pris des bloqueurs de puberté et qu’ensuite de l’oestrogène a été ajouté au traitement, les testicules ne se sont jamais développées. En fait, [le patient] ne fabrique aucun sperme et la capacité à être un parent biologique a été éliminée. En médecine, ne recommande-t-on pas d’enlever des organes inutiles? », soulignait l’endocrinologue pour enfants, Tandy Aye, directrice de la Pediatric and Adolescent Gender Clinic du Lucile Packard Children’s Hospital Stanford en Californie et membre de la WPATH, lors d’une conférence à l’Université du Nevada, en février dernier.
À 78 ans, la feuille de route de la Dre Susan Bradley est impressionnante. Elle a ouvert une première clinique pour transgenres à Toronto en 1975. Son premier patient à avoir fait une transition a aujourd’hui plus de 50 ans. Elle a aussi été psychiatre en chef à l’Hôpital de Toronto pour enfants et professeure de psychiatrie à l’Université de Toronto. Elle a enfin siégé au comité chargé de rédiger la définition de dysphorie du genre dans le DSM 5, qui contient tous les diagnostics reconnus par la profession. La bible des psychiatres, en quelque sorte.
Or, c’est forte de cette expérience qu’elle pose un regard tout différent sur les bloqueurs de puberté, mais aussi sur le mal-être de ces jeunes à qui ils sont de plus en plus prescrits.
Au début des années 2000, Bradley a été une ardente défenseure du protocole de traitement mis en place à Amsterdam - protocole financé par une compagnie pharmaceutique (Ferring) qui fabrique une marque très utilisée de bloqueurs.
« Je me rends compte aujourd’hui qu’en bloquant la puberté, on intervient aussi sur le parcours psychique des adolescents », dit-elle.
« Si l’on n’intervient pas, la majorité des enfants dysphoriques se réconcilient avec leur sexe biologique à la puberté et se rendent compte qu’ils sont tout simplement gais. Mais si on les met sur des bloqueurs, cela n’arrive pas. »
– Dre Susan Bradley
Manifestation précoce de l’homosexualité?
Une dizaine d’études ont été menées à travers le monde et arrivent sensiblement aux mêmes résultats : la majorité des enfants qui vivent une dysphorie de genre se réconcilient avec leur sexe biologique à la puberté.
On parle ici de « désistance ». Le mot n’est pas très français, mais c’est celui utilisé dans le vocabulaire spécialisé.
Et toujours dans une vaste majorité, ces jeunes se révèlent homosexuels.
Ces recherches divisent les spécialistes de la question, qui se disputent à coup d’études, publiées principalement par la revue scientifique International Journal of Transgenderism. Le ton y est plus ou moins courtois, ce qui est plutôt singulier dans le monde sobre des revues scientifiques.
Une des critiques les plus retentissantes de ces études va même jusqu’à suggérer de ne carrément pas faire d’études longitudinales et de seulement écouter les enfants. Elle s’attaque aussi à l’étymologie des mots « persistance » et « désistance » entrés dans le jargon. Ces mots, dit cette critique, seraient péjoratifs.
En Suède, un chercheur a été jusqu’à publier une étude dont la conclusion est pour le moins originale en science : il demande à ses collègues d’arrêter de se chicaner! « Les enfants et leurs familles n’ont pas besoin de cliniciens qui s’engueulent, mais de traitements responsables basés sur des données solides », résume-t-il.
Le lien entre la manifestation dans l’enfance de l’homosexualité et la dysphorie de genre inquiète. Le 8 avril dernier, le Times de Londres publiait d’ailleurs un article dont le titre est troublant : « Ça ressemble à des thérapies de conversion pour enfants gais, disent des médecins. » (It feels like conversion therapy for gay children, say clinicians)
Depuis trois ans, cinq médecins ont quitté le Gender Identity Development Service (GIDS) de Londres. Ils racontent au Times que beaucoup de jeunes gais et lesbiennes victimes d’intimidation croient que le fait de changer de sexe va leur éviter de subir les affres de l’homophobie. Et, selon leurs dires, cela touche particulièrement les jeunes lesbiennes. Les cliniciens s’inquiètent du fait qu’on mette sous traitement, potentiellement, beaucoup d’enfants tout simplement homosexuels et mal dans leur peau au point de se dire qu’il faudrait la changer. Des médecins racontent même que parmi les employés de la clinique, certains faisaient de l’humour noir en disant : « Il n’y aura plus de gais. » (There would be no gay people left)
Néanmoins, ce lien entre homophobie intériorisée et identité de genre préoccupe. L’an dernier, des chercheurs de l’Université de l’Arizona ont voulu savoir si l’intimidation homophobe avait une influence sur l’identité de genre. Résultat : plus les jeunes étaient victimes d’homophobie (insultes, rejet, etc.), plus ils avaient tendance à vouloir changer de sexe.
Jay, Eva Michelle et l’homophobie intériorisée
À l’école, Jay subit les railleries de ses camarades : faggot et autres épithètes homophobes. Et puis, à l’université, il découvre le mouvement trans.
« Tout d’un coup, je n’étais plus anormal, je n’étais plus un homosexuel, j’étais une femme! Ça expliquait tout. J’étais né dans le mauvais corps, et donc, c’était normal que je désire un homme. »
Dans une clinique militante en matière de droits des trans et qui pratique l’approche de « consentement éclairé », on exauce rapidement le voeu de Jay, qui commence un traitement hormonal. Au début, c’est formidable. Il se sent bien. Il s’habille désormais en femme. Il change son nom.
« Je n’ai jamais eu autant de libido qu’à ce moment-là, c’était super chouette. C’était un projet, un rêve de devenir un nouvel être humain, j’étais euphorique. »
Et puis le médecin qui le traite lui offre de passer à une autre étape : il subit l’ablation des testicules. Et là, rien ne va plus. Tout d’un coup, Jay n’est plus capable d’éjaculer. Ce problème va déclencher de l’anxiété et une grosse remise en question. Il sombre dans une dépression profonde et entreprend une thérapie.
Chez son psychologue, Jay se rend compte qu’il a pris une mauvaise route. « J’étais gai et je ne l’acceptais pas. C’était aussi simple que ça. Je n’ai jamais été une femme. J’ai voulu me faire croire et j’ai fait croire à tout le monde que j’étais une femme parce que l’idée de changer de peau quand on n’est pas bien dans la sienne est tellement séduisante! »
« Aujourd’hui, j’ai des seins et un pénis, mon visage est peut-être celui d’une femme, ou d’un homme », soupire Jay, qui dit en plus subir la haine d’anciens amis transgenres pour avoir exprimé ses regrets. Il n’ose même plus se rendre à la piscine, effrayé à l’idée de montrer son corps aux autres.
« Changer de sexe, cela devait me libérer, mais ça a fait l’inverse. J’ai une dépendance aux hormones pour le reste de ma vie. J’ai des chaleurs comme une femme ménopausée et je n’ai pas de relations sexuelles », dit-il.
« Pourquoi personne ne m’a aidé à m’accepter comme un homme gai efféminé? »
– Jay
Notre long entretien se termine, il me chuchote : « J’ai été suicidaire et c’est à cause de ma transition inutile… »
Eva Michelle, elle aussi, se croyait transgenre
« Quand j’ai commencé à avoir mes menstruations, je voulais mourir, me raconte-t-elle. À 14 ans, j’ai demandé à mon médecin d’enlever mes seins. J’hallucinais parfois qu’un pénis était apparu entre mes jambes. »
À 15 ans, elle se rend dans une clinique à Toronto où on lui prescrit rapidement de la testostérone. Elle s’habille alors en garçon, fréquente des militants transgenres. Mais elle ne prend pas ses pilules. « Quelque chose en moi bloquait. »
Puis Eva Michelle tombe amoureuse d’une femme et vit une sorte d’épiphanie. « Ça a été un choc », se rappelle-t-elle, « cette envie d’être une femme lesbienne avec cette femme que j’aimais. Avec elle, dans l’intimité, j’avais vraiment envie d’être femme, pas un homme, c’était très clair. »
Eva Michelle, qui vit aujourd’hui dans l’Ouest canadien, se raconte : « J’ai grandi dans une famille dysfonctionnelle. Je faisais de l’anorexie à l’époque et j’étais malheureuse dans mon milieu très homogène où il n’y avait pas de modèles de femmes lesbiennes, alors j’ai pensé que j’étais un homme transgenre. Aujourd’hui, j’ai accepté mon corps, qui je suis. Je suis masculine, une fille masculine, c’est tout. Pas besoin de prendre des pilules pour ça. »
Le sujet des jeunes transgenres est délicat à aborder pour tout le monde. Les jeunes trans, les jeunes ex-trans, leurs parents, mais aussi les professionnels de la santé. « Ce sont des discussions qu’il est important d’avoir, mais il faut mettre bien des paires de gants blancs », me dit Michelle Blanc. « Ces discussions ne doivent pas nuire aux jeunes transgenres, qui souffrent déjà assez et qui ont besoin d’être pris au sérieux. »
En effet, les personnes transgenres souffrent et les hôpitaux sont en première ligne. À l’unité de pédopsychiatrie de l’Hôpital de Montréal pour enfants, de 20 % à 30 % des adolescents qui y sont admis pour un problème de santé mentale (dépression, pensées suicidaires, etc.) se questionnent par rapport à leur genre.
L’automne dernier, c’était un patient sur deux.
« Le consentement éclairé », entre militance et médecine
Le Dr Martin Gignac, chef de l’unité de pédopsychiatrie de l’Hôpital de Montréal pour enfants, assure qu’un jeune confus ne pourrait pas se jeter dans les bras de la médecine pour changer son corps. « Ça ne se passe pas comme ça au Québec, il y a un travail sérieux et rigoureux, une investigation pour s’assurer que ce n’est pas passager. »
Un peu partout dans le monde occidental, des adolescents convaincus d’être nés dans le mauvais corps discutent entre eux sur des forums sociaux et se donnent des conseils. Comme les listes d’attente sont longues dans les institutions, ils cherchent ce qu’on désigne dans ce milieu où l’on discute majoritairement en anglais des Informed consent clinics, ce qu’on pourrait traduire par des « cliniques de consentement éclairé ».
Ces cliniques se sont multipliées partout en Occident. Sur le site Internet d’une clinique de la Colombie-Britannique, on peut lire la philosophie qui sous-tend cette approche : « Le modèle du consentement éclairé est utilisé en premier lieu parce que nous croyons au droit à “l’autodétermination” des personnes transgenres. Nous croyons que l’identité des personnes transgenres est une identité et ne relève donc pas de la pathologie. » La clinique précise que ça ne veut pas dire « obtenir des hormones sur demande ». À la clinique La Licorne, les jeunes transgenres peuvent consulter dès l’âge de 16 ans. « Si c’est clair pour moi que le jeune sait ce qu’il veut, qu’il est clairement dysphorique et qu’il comprend les effets secondaires des traitements, je peux prescrire rapidement, mais je suis très vigilant, ce sont des traitements sérieux et il faut bien expliquer les bienfaits, mais aussi les risques aux patients », explique le Dr Robert Pilarski qui a fondé tout récemment une clinique du genre à Montréal.
En Ontario, des jeunes impatients de faire leur transition se partagent sur les réseaux sociaux les noms de cliniques adhérant à la philosophie dite du consentement éclairé. Michelle Blanc, qui connaît bien le milieu transgenre à Montréal, n’est pas inquiète. Au contraire, elle salue le travail des cliniciens du Québec qui oeuvrent auprès des jeunes et qui font bien leur travail d’évaluation des dossiers, car, dit-elle, « ce n’est vraiment pas facile d’être une personne transgenre et il ne faut pas prendre l’évaluation à la légère ».
Cependant, certains médecins sont moins scrupuleux. En Ontario, l’automne dernier, le Dr James Scott Bradley Martin, dont la clinique était populaire sur les réseaux sociaux, s’est vu retirer sa licence. Selon le Collège des médecins de l’Ontario, ce médecin, qui voyait une trentaine de jeunes transgenres par semaine, a manqué de jugement en prescrivant des hormones masculines à une adolescente lors d’une première consultation d’environ 30 minutes. Au Québec, le Collège des médecins n’a pas reçu de plaintes de ce genre.
Jay et Eva Michelle ont fréquenté des cliniques de « consentement éclairé » plutôt militantes. « Un jour, j’ai compris que mon médecin traitant était lui-même une femme transgenre », se souvient Jay. Eva Michelle, quant à elle, décrit sa clinique comme un centre de santé très « militant » au centre-ville de Toronto.
Une décision du psy ou du jeune?
« Il faut qu’on se parle! », me dit Marcus Evans de son appartement londonien, « pour le bien des enfants, de tous les enfants, il faut que nous ayons une conversation d’envergure ».
Jusqu’à récemment, ce psychothérapeute d’expérience était un des administrateurs du Tavistock and Portman NHS Foundation Trust, qui héberge le Service de développement de l'identité de genre (GID), le plus important au Royaume-Uni.
Or, cet hiver, Marcus Evans a, comme les médecins qui ont parlé au Times de Londres, remis sa démission. Dans une longue lettre, il déplore ce qu’il estime être une tentative du Tavistock d’occulter un rapport interne, dévoilé récemment dans les médias, dans lequel des cliniciens y oeuvrant dénoncent le fait de n’avoir ni le temps ni le soutien nécessaire pour entreprendre l’évaluation approfondie des jeunes en raison de pressions diverses : de leurs pairs, de groupes pro-trans, des réseaux sociaux, des jeunes et de leurs familles.
« Les cliniciens sont soumis à des pressions pour diriger les cas vers une intervention médicale, et il existe des pressions croissantes pour ne pas interroger les jeunes patients », soutient un psychothérapeute, sous couvert de l’anonymat. D’autres, cités aussi dans le rapport, et encore là de façon anonyme, disent la même chose.
Ces enfants souffrent, il ne le nie pas, au contraire. Qu’ils empruntent la voie qui mène à un changement de sexe peut être la solution, dit-il, mais rien n’interdit « d’approfondir l'engagement avec l'enfant et sa famille avant de prendre de telles décisions ».
« L’enfance et l’adolescence sont des processus de développement complexes. Évitons de sauter aux conclusions », dit Marcus Evans.
Mais comment prendre son temps et du même coup ne pas créer des barrières dans le cheminement difficile d’un adolescent qui ressent un divorce entre lui et son corps? C’est d’ailleurs pour cette raison qu’aujourd’hui, partout dans le monde, on préconise « l’approche affirmative » des jeunes transgenres, car cela diminue leurs souffrances.
À Montréal, Florence Ashley, membre du McGill Research Group on Health and Law et en voie d’obtenir une maîtrise en bioéthique en lien avec la question trans, va même plus loin. Elle vient de publier un article dans le Journal of Medical Ethics qui propose d’abandonner carrément les évaluations psychologiques, même pour les mineurs, dans la mesure où ils peuvent fournir un consentement éclairé. « Les évaluations ne vont pas aider à prévenir les détransitions. On ne peut pas prédire l’évolution du genre. Les évaluations sont très stéréotypées, basées sur des comportements clichés, binaires. Elles découragent une exploration libre et honnête », dit-elle. « Elles peuvent même pousser quelqu’un à mentir et à donner des réponses toutes faites au clinicien pour obtenir la transition voulue », ajoute-t-elle.
L’universitaire souligne aussi que plusieurs détransitionneurs sont heureux d’avoir vécu une transition même s’ils ont changé d’idée. « Certains sont contents d’avoir pu essayer, cela les a aidés à comprendre leur identité. »
L’approche affirmative, ou l’auto-identification
Au Québec, la Fédération autonome de l’enseignement publiait en 2017 un guide intitulé Mesures d’ouverture et de soutien pour les jeunes trans et non binaires.
Les lignes directrices qu’il renferme s’inspirent de l'approche affirmative du genre préconisée par la vaste majorité des spécialistes de la question et par la WPATH.
« Le seul indicateur fiable de l’identité de genre du jeune trans ou du jeune non binaire est son auto-identification. Les mesures mises en place pour ces jeunes doivent être guidées par leur vécu, leurs besoins, leurs expériences et leur volonté explicite », est-il écrit.
Annie Pullen Sansfaçon estime que l’approche affirmative est lasolution. « Quand un jeune affirme que son sexe assigné à la naissance ne correspond pas à son genre, il faut l’accepter », dit cette professeure en travail social de l’Université de Montréal et membre du Pediatric and Adolescent Gender Dysphoria Affirmative Working Group, un regroupement international de médecins, spécialistes en santé mentale, chercheurs et activistes trans. Elle est également mère d’un enfant transgenre.
« Il y a encore des psychiatres qui remettent ça en question, c’est très violent de nier l’identité de quelqu’un. Il y a encore des enseignants qui refusent d’utiliser le bon pronom, ça aussi c’est très violent », estime-t-elle.
La majorité des intervenants estime que le nombre de ceux qui regrettent leur transformation est trop peu élevé pour qu’on remette en question cette approche affirmative qui a fait ses preuves auprès des enfants dysphoriques.
« Ce que nous constatons généralement chez les ados, c'est que le très faible pourcentage qui décident de revenir vers une expression de genre qui correspond au genre assigné à la naissance le font, non pas parce qu'il y a eu erreur, mais parce qu'ils vivent un rejet familial ou qu’ils sont la cible de transphobie », soutient par courriel la psychologue montréalaise Françoise Susset, membre, elle aussi, du Pediatric and Adolescent Gender Dysphoria Affirmative Working Group.
Le Dr Montoro a vu dans sa clinique des jeunes regretter. De 2 % à 5 % des cas. « C’est sûr qu’il y en a qui vont se désister et j’aimerais pouvoir le prévoir, convient-il, mais quand je vois la majorité des jeunes qui arrivent avec une dysphorie de genre et qui, grâce à la transition, vont mieux à l’école, vivent moins d’anxiété, ont moins d’idées suicidaires, je trouve cela très intéressant comme travail. »
« En vérité, nous n’avons aucune idée, aucune recherche qui permet de dire combien il y en a, nuance Dre Susan Bradley. Moi, je suis ce phénomène avec beaucoup d’attention. Il faut écouter attentivement ce que les jeunes “détransitionneurs” ont à nous dire. »
Le directeur médical d’une clinique de genre en Suède a expliqué en avril dernier à la télévision publique que les détransitionneurs vivent le plus souvent de la honte, du rejet et qu’ils sont souvent en crise majeure. Comme de plus en plus de jeunes patients reviennent à cette clinique avec des regrets, on y offre maintenant de la thérapie spécialisée en post-trauma pour détransitionneurs.
Les détransitionneurs veulent être entendus
À la mi-janvier, Helena, Jesse et Dagne se sont donné rendez-vous en personne au Nouveau-Mexique pour une première rencontre dont le but est de fonder une association officielle de « détransitionneurs ». Elles ont toutes la jeune vingtaine. Deux d’entre elles habitent l’Illinois, la troisième le Montana. Elles sont nées femmes, puis à la fin de l’adolescence, elles ont suivi des traitements pour devenir des hommes et ont fréquenté des cliniques de « consentement éclairé » qu’elles qualifient de « militantes ». Aujourd’hui, elles regrettent.
« Nous sommes le Pique resilience project. On veut faire des balados, des vidéos sur YouTube, prendre la parole. Nous refusons d’être réduites au silence. Il est important qu’on nous entende! » clament-elles dans une entrevue qu’elles m’ont accordée par Skype.
Les trois filles mettent le doigt sur des bobos contemporains et un mal-être féminin troublant.
« Nous savons, nous, que nos expériences sont représentatives d’un nouveau phénomène, d’un malaise. »
– Jesse
Helena avait peur d’être une femme
À 16 ans, Helena découvre le mouvement trans sur les réseaux sociaux. À 18 ans, elle commence la testostérone, hormone qu’elle prendra pendant 17 mois. « À 19 ans, je me suis rendu compte que c’était une erreur et j’ai arrêté. »
Adolescente, elle détestait ses hanches, ses seins naissants, et souffrait d’anorexie. « Je détestais l’expression physique de ma féminité. Mes seins, mes hanches étaient synonymes d’une prise de poids. Je ne mangeais presque plus, et puis je me suis dit : “les gars, eux, ne vivent pas ça” ».
Helena évoque des phénomènes contemporains qui, dit-elle, rendent l’idée de ne plus être femme… attirante.
« Sur Instagram, avec les images de filles super belles, féminines, sexy, tu te dis qu’il n’y a pas d’autres voies. Je me disais : “Je vais devoir devenir une bombe sexuelle, me taire, être consommable”. Ça a déclenché en moi une peur intense, une anxiété intolérable et, de l’autre côté, je ne voulais pas être lesbienne ».
Helena se souvient de crises à la maison. « Quand ma mère me disait : “Tu peux être une fille sans tomber dans ces clichés de filles. Tu peux être une fille comme tu l’entends”... Je criais : “Non, je ne veux pas être une lesbienne poilue! Non! Pas lesbienne! Je suis un homme, je suis un homme!” »
La pornographie a beaucoup contribué à alimenter ses frayeurs. « À l’école, j’entendais les gars parler de la porno qu’ils découvraient sur Internet. Je trouvais ça dégueulasse, la façon dont on y humiliait les femmes, la pornographie basée sur les viols en particulier. Ça ne te donne vraiment pas le goût du tout d’être une femme. »
Jesse ne s’aimait pas
Jesse ne voulait rien d’autre qu’être bien dans son corps. Or, très jeune, elle a déjà cette impression que ce corps qu’elle habite n’est pas le sien. Aussi, à 18 ans, elle change de nom, s’identifie comme homme trans et commence la testostérone.
« J’ai vécu des traumatismes dans mon enfance et je pensais que changer de sexe pouvait constituer une échappatoire à ma vie. Toute mon anxiété était canalisée là-dedans. Devenir un homme devenait un changement positif, la possibilité de me réincarner. »
Pendant plus d’un an, Jesse est très heureuse, puis les effets secondaires des médicaments commencent à lui peser. La testostérone change son humeur, elle fait des colères. Elle a des palpitations cardiaques.
« Je n’étais pas satisfaite non plus des changements physiques », constate-t-elle. « Sur les médias sociaux, il y a cette mode des superbes hommes trans, des youtubeurs populaires qui deviennent super attirants. Je savais que je ne deviendrais pas un super modèle, mais je voulais me sentir super cool. Et puis, ça m’a frappée. J’ai réalisé que c’était une sorte de fantasme ou de mirage. J’ai compris, me dit-elle, sourire en coin, que la transition ne me transformerait pas en superbe youtubeur sexy et que je serais toujours moi-même. »
Dagne avait un malaise à être une fille
« J’avais 15 ans quand j’ai découvert qu’une fille pouvait devenir un gars sur les réseaux sociaux », se souvient Dagne. « Je savais à l’époque que j’étais bisexuelle et je me suis fait un compte Tumblr. J’ai commencé à m’identifier moi-même comme un homme trans. Je l’ai dit à mes parents. Pendant deux ans, je les ai harcelés pour avoir des hormones. »
Dagne commence le traitement à 17 ans. Et puis, lors de sa deuxième année d’université, loin de chez elle et de ses amis trans, elle tombe amoureuse d’une fille et discute beaucoup avec elle. « Je me demandais pourquoi je ne voulais pas être une fille. Qu’est-ce qui faisait que j’éprouvais un malaise à être une femme? Pourquoi me détestais-je tellement? Pendant six mois, ça m’a habitée. Je me demandais si c’était une nouvelle phase de ma dysphorie du genre et puis, un matin, j’ai arrêté les hormones et je suis retournée au pronom elle. »
« Être trans, non seulement ça ne m’a pas apporté de bonheur, mais ça a empiré mes problèmes de façon significative. C’est une des raisons pour lesquelles j’ai fait une détransition. Je ne voulais pas être triste pour le reste de ma vie. Être trans m’a rendue tellement malheureuse, plus malheureuse que je ne l’ai jamais été. Personne ne veut entendre cela. »
Dagne regrette en particulier que des adultes l’aient laissée porter des bandages sur ses seins naissants.
« Je faisais partie de l’équipe de natation et j’avais une assez bonne capacité respiratoire, mais à 22 ans, ma capacité respiratoire est endommagée. Mes poumons et ma cage thoracique ont été opprimés à un moment où mon corps se développait. »
– Dagne
Jesse déplore les effets de la testostérone sur son corps. « J’ai des séquelles importantes autant physiquement que mentalement. Aujourd’hui, cette idée de changer de corps, qu’on dit progressiste, me semble paradoxalement rétrograde. Il y a de la place dans notre société pour des gens qui ne se conforment pas à leur genre biologique, mais qui peuvent être différents, non binaires, sans prendre des médicaments toute leur vie. »
Une étude sur les « détransitionneurs » jugée politiquement incorrecte
James Caspian, psychologue spécialisé dans l’identité de genre, vit à Londres. En 2016, il est contacté par un chirurgien plastique de Belgrade, en Serbie, qui opère de plus en plus fréquemment des gens qui regrettent d’avoir changé de sexe et qui veulent revenir à leur sexe initial.
Caspian ne s’en étonne pas.
À peu près à la même époque, le psychologue reçoit un courrier électronique d’une organisation de jeunes femmes aux États-Unis, qui se désignent comme des re-genders, ou « re-genrées ». Elles voulaient organiser leur premier congrès.
Caspian est un défenseur de la cause des jeunes trans depuis longtemps et a siégé pendant des années au C. A. du Beaumont trust, qui finance des programmes d’aide aux jeunes trans en Angleterre.
Le spécialiste se dit qu’il y a, chez ces gens qui regrettent, un phénomène à étudier. Il dépose donc un projet de recherche sur la désistance à la petite Université Bath Spa. La réponse : le sujet n’est pas politiquement correct.
Le psychologue a décidé de poursuivre l’Université, ce qui a suscité quelque intérêt dans les médias britanniques et a valu à James Caspian des dizaines d’appels et de courriers électroniques acerbes. « Les activistes trans craignent que ces histoires-là fassent reculer les droits des jeunes trans », explique Caspian. Et cela, il le comprend, et il compatit, car il connaît les épreuves traversées par les personnes transgenres.
Mais il invoque le serment d’Hippocrate. « Nous ignorons les voix de ces gens qui disent qu’on leur a fait du mal en leur prescrivant une transition qui s’est avérée non souhaitable. »
C’est pour cela qu’il juge qu’il faut essayer d’avoir plus d’empathie pour ces jeunes qui changent d’idée.
Un phénomène de contagion sociale?
Samuel Veissière porte des tatouages sur les mains et le torse et, invariablement, une petite tuque qui semble collée sur sa tête. Il pourrait être l’égérie d’un groupe grunge, mais il est professeur d’anthropologie médicale à l’Université McGill et, à ce titre, s’intéresse à l’expression de la détresse dans nos sociétés modernes.
Il a étudié l’impact des réseaux sociaux sur la dépression chez les jeunes, le malaise des hommes à l’ère du #metoo. Bref, il analyse et étudie l’impact sur la psyché humaine de phénomènes contemporains.
C’est donc avec ces considérations en tête qu’il a publié un article de vulgarisation scientifique, en novembre dernier, dans la prestigieuse revue américaine Psychology Today.
Le professeur fait écho à une hypothèse développée, au terme d’une enquête, par la professeure Lisa Littman de l’Université Brown, au Rhode Island, pour expliquer l’explosion du nombre d’adolescents se définissant comme transgenres, particulièrement des jeunes filles.
« Lisa Littman a développé une hypothèse voulant qu’au-delà des cas types de dysphorie du genre, dont les symptômes apparaissent dans la petite enfance et autres cas types d’adolescents dysphoriques, il y aurait un nouveau phénomène qu’elle appelle le ROGD, le rapid onset gender dysphoria, qu’on peut traduire par “déclenchement rapide de la dysphorie de genre” ».
Il existe même désormais une association de parents qui porte le nom du concept. Parents of ROGD Kids (parents d’enfants ROGD) est présente dans une quarantaine de villes aux États-Unis et au Canada et a d’ailleurs été fondée par une Canadienne.
« Ce phénomène apparaîtrait à l’adolescence avec la fréquentation assidue de sites Internet spécialisés et de pairs, à l’école, qui eux-mêmes, s’identifient comme des personnes trans », explique Samuel Veissière, reprenant la thèse de Lisa Littman.
« Moi, j’y ai ajouté l’hypothèse qu’il y aurait certains déclencheurs sociogéniques, sorte de contagion sociologique, dans le développement de cette identité trans chez certains jeunes. » Pas tous, insiste-t-il, « mais certains ».
L’article du professeur Littman, publié en août 2018 dans le magazine PLOS One, s’est attiré les foudres de chercheurs et d’activistes trans. Bien que publié – et donc revu par un comité de pairs – l’article a été attaqué sur sa méthodologie et a fait l’objet d’une révision. L’Université a d’ailleurs retiré le communiqué en faisant la promotion sur son site, ce qui a suscité des accusations de censure, notamment de l’ex-doyen de la faculté de médecine de l’Université Harvard, le Dr Jeffrey S. Flier.
Ses détracteurs lui reprochent, entre autres, d’avoir recruté ses répondants sur des sites de parents inquiets, donc possiblement transphobes, et affirment en outre que les parents sont, de toute façon, de mauvais juges de ce qui se passe dans la vie, le coeur et la tête de leurs adolescents.
La question transgenre, un tabou?
L'accueil fait à l’article de Samuel Veissière, intitulé Pourquoi l’identité trans augmente-t-elle chez les adolescents? Une nouvelle étude sur la contagion sociale suscite d’importantes questions éthiques et cliniques, n’a pas été chaleureux. C’est le moins qu’on puisse dire.
Dans son petit bureau de la faculté de psychiatrie de l’Université McGill, il nous lit quelques messages reçus après la publication de son article. « Écoutez celui-ci : “Vous êtes coupable d’une telle violence vis-à-vis des enfants transgenres, on devrait vous mettre en prison!’’ »
« Je crois fermement que les personnes dysphoriques du genre devraient recevoir les traitements adéquats et la recherche démontre qu’il est vital d’aider ces gens rapidement. Il ne s’agit pas de nier cette évidence parce que c’est une évidence, mais simplement de poser des questions sur certaines données nouvelles comme le déclenchement rapide de la dysphorie notamment chez les jeunes femmes », dit-il.
Des expériences comme celle du professeur Veissière font craindre à plusieurs intellectuels d’aborder la question transgenre.
« Mes collègues me disent de m’abstenir de publier sur le sujet, car la question transgenre est une sorte de nouveau tabou. »
La plupart des détransitioneurs à qui nous avons parlé nous ont raconté avoir été très militants lors de leur période trans. « C’est nous contre eux », raconte Jay. « Mes amis trans et moi, on s’encourageait à dénoncer tout ce qui pouvait être perçu comme une discrimination, à attaquer ceux qui utilisaient le mauvais pronom, à traiter de “transphobe” quiconque posait des questions. Ironiquement, je fais aujourd’hui partie de ce qu’ils considèrent comme un ennemi de la cause. »
Les activistes trans sont-ils plus virulents que d’autres? « Non », répond d’emblée Florence Ashley. « Internet est virulent. C’est juste que nous sommes tellement une minorité que parfois, il faut parler plus fort pour être entendu. »
Le professeur Veissière a eu la surprise d’être pris à partie par le Gender Dysphoria Affirmative Working Group, dont plusieurs Québécois sont membres, qui a demandé à Psychology Today de retirer l’article de son site.
« Nous avons tous une vaste expérience dans le domaine de l’identité de genre et nous éprouvons un malaise avec la notion de déclenchement rapide de la dysphorie du genre. »
– Pétition du Gender Dysphoria Affirmative Working Group
« L’étude de Littman est une recherche biaisée avec une méthodologie bancale qui peut causer beaucoup de tort aux enfants », soutient Annie Pullen Sansfaçon. Elle compare même cette fameuse étude à celle qui lie, à tort, vaccins et autisme chez les enfants.
Elle reconnaît que les médias sociaux jouent un rôle, mais pas celui avancé par Littman et Vessière.
« Nos recherches nous disent que les jeunes découvrent souvent la trans-identité par les médias sociaux, mais cela leur permet seulement de nommer les choses, de mettre le doigt sur un malaise qu’ils ne comprenaient pas », affirme-t-elle.
La WPATH a elle aussi rejeté de façon très claire le concept même d’un déclenchement subit de dysphorie du genre et de l’hypothèse de contagion sociale. Elle demande à ses membres « d’éviter d’utiliser tout concept qui instille la peur qu'un adolescent puisse ou non être transgenre dans le but de ne pas envisager toutes les options thérapeutiques appropriées ».
Si l’hypothèse de Littman rencontre une résistance acharnée, elle a cependant l’appui d’une sommité dans le domaine, la Dre Susan Bradley.
« Non seulement je n’ai pas peur de dire que l’étude de Littman n’est pas du tout à rejeter du revers de la main, mais je serais à l'aise d'utiliser les informations qu’elle a colligées dans son article. Dans plusieurs pays, on a vu que plusieurs filles s’affichent comme transgenres lorsque d’autres le font à l’école, c’est donc une explication logique de cette augmentation soudaine à laquelle on assiste depuis quelques années. »
« J’ai 78 ans et je n’ai pas peur de dire ce que je pense. Personne ne peut m’accuser de transphobie quand même. » Elle rit et déclare, confiante : « Parce que si moi je suis transphobe... »
Le 19 mars dernier, après avoir soumis l’étude controversée à un comité scientifique, pour révision après publication, la revue PLOS One a décidé de republier les résultats de Lisa Littman, mais sous un nouveau titre qui stipule clairement que ce sont des faits rapportés par les parents et non par des adolescents ou les jeunes adultes eux-mêmes.
Vers plus de sérénité
Le Dr Richard Montoro croit que, tranquillement, on arrivera à un dialogue plus serein, notamment au sujet de ceux qui regrettent d’avoir fait la transition.
« La population trans a tellement été discriminée longtemps, qu’il y a une immense méfiance par rapport à ce sujet-là, car chat échaudé craint l’eau froide. Mais plus les droits des trans seront respectés, plus on sera capables d’aborder certains sujets », croit-il.
« Tu dis que tu es trans et on tient ça pour acquis, me dit Jesse. C’est très rapide. Et, autant je crois que le mouvement trans cherchait, de bonne foi, au départ, à aider des gens mal dans leur peau, autant je crois que cette posture peut être dangereuse. Regardez-nous, dit-elle, parlant d’Helena, de Dagne et d’elle-même, nous étions des adolescentes angoissées, mal dans leur peau. La transition a, chez chacune de nous, généré une détresse extrême. Je n’ai jamais été aussi suicidaire que lorsque j’étais en train de changer de sexe. »
Jay, lui, a trouvé un certain réconfort avec son réseau d’échange « r/detrans », un sous-groupe de discussion sur le réseau social Reddit.
Fondée il y a deux ans, la plateforme compte maintenant plus de 1700 membres.
Clara est venue me rendre visite à Radio-Canada. Dans un studio, elle s’est installée devant le micro et a commencé à lire sa lettre intitulée : Je pensais que j’étais trans.
Elle était apaisée.
*Certains prénoms ont été modifiés pour conserver la confidentialité
Emilie Dubreuil journaliste, Melanie Julien et Bernard Leduc chefs de pupitre, André Guimaraes développeur, Francis Lamontagne designer, Charlie Debons-Ricard motion designer et Danielle Jazzar réviseure