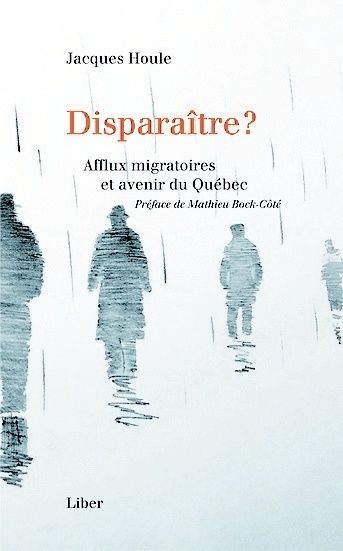Notes de lecture. Jacques Houle, Disparaître. Afflux migratoire et avenir du Québec,
préface de Mathieu Bock-Côté, Liber, 2019.
Depuis Lord Durham, la nation originaire de la Nouvelle-France est sujette à des accès récurrents d’angoisse de disparition. Déjà en 1840, Étienne Parent s’était résigné à l’assimilation promise aux Canadiens français. Vaguement rassurée par la portion d’État qui leur était dévolue à la fondation du pays, et surtout par l’édification d’une solide armature ecclésiale porteuse de la nation, les Canadiens français n’en restaient pas moins catastrophés par la saignée démographique vers les États-Unis ainsi que par l’anglicisation galopante des minorités de la diaspora. Celle de la Nouvelle-Angleterre rendait les armes à la fin des années 1920; quarante ans plus tard, la nation elle-même s’amputait officiellement de celles du Canada, pour se replier sur le territoire du Québec. Entretemps, Lionel Groulx s’était efforcé de ranimer ce «petit peuple de l’espèce tragique», de ceux qui ne savent pas s’ils existeront encore demain, tandis que Victor Barbeau fustigeait les clercs se gargarisant de lieux communs sur «les raisons qu’ont les Canadiens français de ne pas désespérer». «Vous n’êtes pas écœurés de mourir, bandes de caves», affichera plus tard l’artiste sur les murs du Grand Théâtre de Québec, érigé à la gloire du centenaire de la (Con)fédération. Plus flegmatique, Jacques Ferron se souciait surtout «qu’au moins le croque-mort sache qui il prépare pour sa dernière parade ».
Au seuil de l’avènement du Parti québécois – le seul qu’aura peut-être connu le Québec à avoir des politiques dignes de ce nom – Pierre Vadeboncœur publiait un prophétique Génocide en douce de ce peuple qui avait eu «la vocation de la défaite et l’insolence de subsister quand même*». Au banc des accusés : «l’infamie capitaliste », « diamétralement incompatible [avec] la protection du milieu écologique, la pauvreté [...] et l’avenir humain**». (La pauvreté, s’entend, pas la misère, à savoir une immunité au «poison de l’idée d’enrichissement***»). Et secondairement, le racisme anti-québécois. Le pronostic était sombre: «tout se décidera [...] d’ici un demi-siècle peut-être, peut-être moins [...] et pour toujours si [les Québécois] sont vaincus****». Nous y sommes.
Les perspectives de population pour les années 1980, établies par les démographes de 1960, ont été radicalement démenties par une chute aussi brutale qu’imprévue de la fécondité, renforcée par un déficit migratoire interprovincial chronique. Au lieu du minimum de huit millions attendu, la population du Québec n’avait atteint que les six millions. À l’inverse, les pronostics les plus optimistes de 1980, si on faisait l’hypothèse d’un redressement de la fécondité et d’un solde migratoire modestement positif, reportaient aux années 2020 le huit millions en question, qui fut pourtant atteint une décennie plus tôt. Non par un redressement de la fécondité: par la hausse de la longévité ainsi que par l’afflux migratoire. On estime le taux de rétention de ces immigrants à 80%. Nonobstant le solde migratoire interprovincial, immigrants et natifs confondus, qui est resté négatif, fluctuant dans une large fourchette autour de dix mille selon la conjoncture de l’emploi, ça laisse un bon surplus dû à l’immigration internationale, surtout après la hausse amorcée en 2007 et que le présent gouvernement s’est empressé d’entériner. Bref, plus de vieux pas pressés de mourir, plus d’immigrants moins pressés de repartir, mais pas beaucoup plus d’enfants.
Contre le vieillissement de la population, la pénurie de main-d’œuvre ou l’amélioration des finances publiques, l’immigration est un «remède imaginaire» rétorquaient en 2011 le spécialiste en politiques publiques Benoît Dubreuil et son complice, le démographe Guillaume Marois. «L’effet de l’immigration sur la prospérité du Québec est marginal mais son effet sur la composition de la population est à la fois profond et durable*****». Les rares experts consultés par le gouvernement Charest s’étaient montrés très réticents à une hausse de l’immigration. «Nous sommes déjà débordés de néo-Québécois qu’on est incapable d’intégrer» au marché du travail, déclarait entre autres le réputé économiste Pierre Fortin en 2008******.
Dubreuil et Marois annonçaient s’en tenir strictement sur le plan de la démographie et de l’économie, tout en reconnaissant qu’il existait d’autres dimensions au problème de l’immigration. En s’appuyant sur quelques données de cette étude, enrichies de mises à jour récentes, Jacques Houle, ancien cadre à Emploi et Immigration Canada, ramène dans le décor l’angoisse de la disparition. Il ne s’agit pas seulement d’un processus endogène, par sous-fécondité, mais d’une immersion sous l’afflux migratoire. Plutôt qu’un diagnostic rationnel empiriquement fondé, affranchi de la rectitude politique et tenant sous contrôle ses propres positions politiques, à la manière de ses prédécesseurs de 2011, il présente un vigoureux réquisitoire, développé en sept chapitres de longueur variable. D’abord un rappel historique sur «l’ethnocide de la nation française d’Amérique du Nord [...] bien enclenché dès 1851» (p. 21), suivi de quelques données sur l’évolution de l’immigration jusqu’à aujourd’hui, y inclus les irréguliers et les «bébés passeport» (nés d’une mère étrangère venue accoucher en sol québécois, qui obtiennent ainsi la citoyenneté canadienne, ouvrant plus tard la porte pour toute la famille). Houle s’arrête plus longuement sur le thème de la «désintégration de la majorité historique», qui est le cœur de son propos, en insistant sur la situation de Montréal. Par «majorité historique», il entend évidemment la nation de ceux qui se nommaient jadis Canadiens, puis Canadiens-Français, édulcorés en Canadiens français, puis Québécois et qui n’ont plus aujourd’hui ni de nom propre ni de définition précise. Dans le même paragraphe en introduction (p. 29), on lit «majorité d’ascendance canadienne-française», ce qui exclut les nombreux assimilés, souvent repérables à leur patronyme exotique ou leur faciès un peu sombre. Et «majorité de langue maternelle française», ce qui inclut les minorités audibles telles que les Franco-Québécois (immigrants français). Puis «majorité historique francophone», ce qui est à la fois plus juste et plus vague. Quoi qu’il en soit, cette «majorité historique» est devenue minoritaire sur l’île de Montréal; c’est l’anglais qu’il faut maîtriser pour pouvoir travailler; les immigrants refusent de participer aux cours de francisation; un enfant d’immigrant sur cinq s’identifie à la majorité – vraisemblablement parmi ceux qui sont issus d’un mariage mixte.
L’afflux d’immigrants se traduit par l’anglicisation de Montréal et la formation de ghettos ethniques. «La généralisation du bilinguisme comme critère d’embauche s’est faite sans que l’employeur ait même à le justifier» (p. 50). Il aurait fallu «aller moins vite» et ajuster l’immigration «à notre capacité réelle d’absorption linguistique, culturelle et sociétale » (p. 46). Contrairement aux gouvernements péquistes, les Libéraux ont persisté à maintenir un haut niveau d’immigration sous divers prétextes économiques, au premier chef: la pénurie de main-d’œuvre. Or il n’y a pas de pénurie de main-d’œuvre qualifiée, celle qui est censée répondre aux critères de sélection du Québec, mais au contraire pénurie d’emplois qualifiés. Le cri d’alarme des employeurs concerne principalement la main-d’œuvre peu qualifiée et mal payée: «secteurs de la restauration-hébergement, du tourisme, du commerce au détail, des centres d’appel, des services et des soins aux personnes» (p. 89). Le véritable motif de cette immigration trop massive et mal ciblée saute au nez: «Les Néo-Québécois, issus de l’immigration, à l’instar des Anglo-Québécois, votent de manière quasi unanime et à des niveaux soviétiques pour le PLQ et contre la souveraineté.» (p. 58)
Contre « la disparition programmée du peuple québécois » (p. 106), Houle propose le modèle japonais, société démographiquement très vieille, où l’immigration est marginale, qui supplée à la pénurie de main-d’œuvre par la robotisation et qui a su conserver sa prospérité économique tout en préservant son homogénéité culturelle. Les «solutions claires et énergiques» (p. 117) qu’il propose restent tout de même un peu molles ou irréalistes. Un retour au seuil de 30 000 immigrants choisis en fonction de «la plus grande proximité culturelle possible» (p. 118)? Pourquoi ne pas abolir simplement tout le programme des immigrants économiques, sauf pour cette catégorie d’emplois où les besoins en main-d’œuvre vont inévitablement croître, à savoir les soins aux personnes âgées? Il resterait encore tous les réfugiés politiques à qui le Québec offre l’hospitalité, depuis les Hongrois de 1956 jusqu’aux récents Syriens, en passant par les Chiliens de 1973, les Vietnamiens, les Libanais, les Haïtiens… en attente des réfugiés écologiques, qui ne vont pas tarder. Quant aux immigrants économiques, ils ne demandent pas l’hospitalité, seulement l’autorisation de venir s’installer ici, ce qui n’est pas tout à fait équivalent.
Houle préconise aussi de récupérer au Québec l’entière compétence en matière d’immigration, en s’inspirant de la «pugnacité» de Maurice Duplessis dans le dossier de l’impôt provincial (p. 127). Et la robotisation des industries dans le secteur manufacturier, le commerce de détail, les institutions financières et les mines (p. 129), de façon à économiser le besoin de main-d’œuvre. Pourquoi ne fermerait-on pas plutôt plusieurs entreprises dans les secteurs écologiquement nuisibles, si rentables soient-ils dans le système économique actuel, telles que les mines ou le tourisme? Encourager la natalité par «la promotion enthousiaste de la famille» (p. 132)? Il serait plus réaliste de «changer la mentalité» de l’école, appelée à favoriser l’assimilation d’enfants d’immigrants en leur transmettant une «culture publique commune» plutôt que de leur inculquer l’idéologie multiculturelle. «L’impératif de la dispersion hors Montréal par la régionalisation» (p. 123)? Il existe une petite proportion d’immigrants à Québec et en régions, qui n’ont guère le choix que de s’intégrer; pourquoi y exporterait-on le problème de Montréal?
Dans sa préface, Mathieu Bock-Côté relie la question de l’immigration à celle de la souveraineté, en ramenant dans le décor la célèbre déclaration de Parizeau au soir du référendum de 1995, qu’il cite incorrectement, comme tout un chacun, même en connaissance de cause – Dubreuil et Marois le signalent par une mise entre crochets du [les] – donnant ainsi à comprendre « le vote des ethniques», ce qui comporte la même différence avec l’exact «des votes ethniques» que le vote des syndiqués avec un vote syndical ou le vote des femmes avec un vote féministe. Il faisait bien sûr référence à une coalition juive-grecque-italienne appelant leurs congénères à voter (ethniquement) pour le NON. Déclaration «déplacée» jugent Dubreuil et Marois – aurait-il pu la placer ailleurs? Ce qu’il y avait là de contestable, en fait, c’est que Parizeau n’exprimait que la moindre partie de la vérité; l’important, il l’avait dit durant la campagne référendaire, à savoir qu’on n’avait pas besoin des ethniques pour faire la souveraineté – déclaration qui n’est pas passée à l’histoire. Effectivement, ce n’aurait pas été trop demander aux Québéquiens de se prononcer aux deux tiers pour eux-mêmes. On peut ainsi considérer que la souveraineté a été perdue dans le ventre mou de Québec, où il n’y a pas suffisamment d’immigrants pour alerter la conscience nationale, plutôt que chez les ethniques de Montréal. «Si on ne l’a pas eu, c’est qu’on ne l’a pas mérité», philosophait Gilles Vigneault.
Le solide texte de Bock-Côté pose clairement le problème, en radicalisant le diagnostic de l’auteur. Le peuple québécois «se laisse intégrer dans un nouveau peuple montréalais multiculturel et bilingue [...] comme en témoigne le rejet viscéral d’une éventuelle charte de la laïcité [...] dans un processus de sécession mentale avec le Québec » (p. 15). Le préfacier ne propose pas de solution concrète, tout en refusant de déclarer forfait. Il y a lieu d’être plus pessimiste. Coincée entre la dictature de la mondialisation et le gouvernement des juges, l’instance politique n’a plus beaucoup d’autre pouvoir que la gestion à la petite semaine des problèmes sociaux. Les jeunes gens se désintéressent donc du politique, la souveraineté ne les interpelle plus, ils nagent dans la culture américaine, parlent des deux côtés de la bouche et déplorent de n’avoir pas été autorisés à fréquenter l’école anglaise. Ça ne fait pas une grosse perspective d’avenir. Disparaître? Pour le moment, la nation s’estompe en douce sur l’île de Montréal, tandis que le résidu de l’ancien empire français d’Amérique se rétracte sur le reste du Québec.
* Pierre Vadeboncœur, Un génocide en douce, Montréal, L’Hexagone/Parti pris, 1976, p. 42.
** Vadeboncœur, Un génocide…, p. 15.
*** Vadeboncœur, Un génocide…, p. 14.
**** Vadeboncœur, Un génocide…, p. 47.
***** Benoît Dubreuil et Guillaume Marois, Le remède imaginaire. Pourquoi l’immigration ne sauvera pas le Québec, Montréal, Boréal, 2011, p. 14.
****** Cité par Dubreuil et Marois, Le remède imaginaire, p. 38.