La semaine dernière, devant la chambre de commerce du Montréal métropolitain, Louis Audet, de Cogéco, s’en est pris violemment à la Charte des valeurs.L’argument était attendu et il est venu: la Charte des valeurs mettrait l’économie en péril et nous ferait passer du modèle de la société ouverte à la société fermée. L’immigration serait indispensable à la prospérité économique des sociétés modernes et il faudrait créer un environnement juridique et social permettant «aux valeurs multiculturelles» d’éclore. La Charte dissuaderait les immigrants de s’installer au Québec en plus de lui faire honte à travers le monde, en lui collant l’image d’une société xénophobe. Avec les nuances dues au changement d’époque, on aurait cru réentendre les mises en garde contre la Charte de la langue française, en 1977, quand on prophétisait la catastrophe et on dénonçait la tentation autoritaire pour inviter le gouvernement à renoncer à légiférer sur la langue.
Tout cela est présenté comme une évidence. Pourtant, nous le savons, il n’y a pas nécessairement de lien entre l’immigration et la prospérité d’une société. Dans Le remède imaginaire : pourquoi l’immigration ne sauvera pas le Québec (Boréal, 2011), Benoit Dubreuil et Guillaume Marois, et Michèle Tribalat dans Les yeux grands fermés (Denoël, 2010), rappelaient que l’apport économique de l’immigration était neutre. De même, elle ne contribue pas significativement au rajeunissement de la population: en d’autres mots, elle ne payera pas les pensions. Cela ne veut pas dire qu’il faut fermer les frontières, aucunement, et qu’il faudrait cultiver à l’endroit des immigrants de mauvais sentiments, ce qui serait profondément détestable, mais qu’on aurait tort d’investir des espoirs exagérés dans les capacités rédemptrices de l’immigration pour l’économie ou la résolution des problèmes sociaux. Il n’est pas interdit non plus d’ajuster non seuils d’immigration selon nos capacités d’intégration.
Abolir la souveraineté nationale ?
Mais plus encore que la valeur de cet argument, éminemment discutable, il faut questionner la vision du monde qu’il révèle et qui est dominante: je parle de cette utopie «globaliste» qui entend unifier le genre humain par le marché et les «droits fondamentaux» (tout en étendant sans cesse la définition de ceux-ci, ce qui contribue justement à diluer leur valeur), en abolissant les frontières comme les États et en privatisant les cultures. Je parle de ce «sans-frontiérisme» généralisé qui veut neutraliser les cultures historiques et atténuer le plus possible les différences entre chaque État-nation. En fait, à travers cette utopie, les distinctions entre les peuples et les États seraient appelées à se dissoudre, et l’humanité, enfin, trouverait à renaître après avoir décrypté le secret de son unité. Plus encore, les contradictions humaines, pourtant créatrices de sens et témoignant des nombreuses manières de faire société, seraient appelées à se dissoudre à travers les avancées du progressisme mondialisé, dont certains auraient eu la révélation, et qui voudraient dès lors nous y convertir.
La souveraineté nationale est ici considérée comme un archaïsme à abolir, et les identités historiques, comme autant d’obstacles à l’hybridation globale par laquelle l’humanité pourrait s’unifier. L’individu parfaitement libéré pouvant alors exercer sa liberté mondialisée en passant d’une société à l’autre. L’heure serait à citoyenneté touristique où l’homme picorerait dans tous les pays selon ses désirs et besoins du moment, mais ne se sentirait vraiment appartenir à aucun – tel est le citoyen du monde, qui confond son éparpillement existentiel avec un authentique cosmopolitisme. La liberté se penserait désormais comme désaffiliation envers la communauté politique, l’identité nationale et l’héritage de civilisation. Il n’y a plus de peuples, seulement des populations, appelées elles-mêmes à être traitées comme autant de «ressources humaines». Ici, la marchandisation des rapports sociaux pave la voie à une forme de capitalisme libéré de ses harnais politiques, moraux et culturels, et consentant à sa tentation de la démesure : le politique doit se dissoudre dans la gestion, qui doit se dissoudre dans l’économie, et tout cela, dans un présent perpétuel sans conscience historique. La mondialisation exigerait qu’on s’y adapte rigoureusement, et surtout, entraine le ralliement d’une frange dominante des élites qui espèrent souvent se faire coopter par son système, en rejoignant le «peuple mondial».
L’enracinement comme pathologie?
Dans cette perspective, l’enracinement est d’ailleurs présenté comme une pathologie, parce qu’il limite la mobilité absolue des individus (et des travailleurs) qu’on voudrait indifférents à leur propre culture et ne désirant plus accomplir une partie de leur être dans la cité. C’est ainsi qu’on chante le nomade se promenant dans tous les pays pour gagner son pain, comme s’il s’agissait d’une forme de vie supérieure à celle des hommes attachés à leur pays et désirant y mener leur existence. L’homme ne devrait plus vouloir un chez-soi – car la référence au «chez-soi» ne pousserait-elle pas à une distinction illégitime entre «nous» et les «autres» ? En fait, c’est l’existence même d’un «nous» historique et politiquement balisé qui causerait problème, car il pousserait à «l’exclusion», celle-ci servant à disqualifier toute distinction entre ceux qui sont citoyens d’un pays et ceux qui ne le sont pas. Il n’y a plus qu’un seul nous : celui des élus de la mondialisation, qui se réclament de l’ouverture, de la tolérance et qui se piquent de sophistication mondaine, mais qui peinent à imaginer qu’on ne puisse pas désirer le même genre de société qu’eux.
L’homme ne devrait plus tolérer de médiation entre son existence individuelle et l’humanité. Il ne devrait surtout plus vouloir s’unir politiquement avec des hommes partageant une culture, comme si le désir d’identité collective avait quelque chose d’une tentation fascisante. À chaque moment, on distingue ainsi les sociétés entre ceux qui embrasseraient le progrès et les autres tentés par la régression identitaire, comme s’ils voulaient s’enfermer dans un cocon et ne plus interagir avec le monde. Ainsi pensée, une société est faite de forces vives et de bois mort, et il est permis de mépriser ceux qu’on classe dans la seconde catégorie. La citoyenneté devrait se définir exclusivement en termes procéduraux et se délester de tout substrat historique particulier – pour reprendre les mots de Pierre Manent, il n’y aura plus de corps politique substantiel, car le politique lui-même se réduira à une simple instance de gestion de droits préexistant à la souveraineté populaire et nationale. Il y aura encore des pays, mais comme autant de résidus historiques ne devant plus s’exprimer politiquement.
L’histoire hoquette ici. Un certain socialisme et un certain libéralisme ne se sont-ils pas longtemps rejoints, à bien des égards, dans le rejet de la nation et de l’esprit national? La gauche multiculturelle et la droite néolibérale renouent cette alliance et se montrent particulièrement décidées à en finir avec ceux qui ne communient pas au même autel qu’elles. Le résultat a quelque chose d’aussi glacial que terrifiant : une société terriblement atomisée où chacun est d’autant plus jaloux de ses droits qu’il ne se sent plus existentiellement lié à ses compatriotes – en fait, chacun s’emmurera dans ses désirs qu’il traduira en droits parce que le fait même d’appartenir à une société qui n’est pas exactement le reflet de ses désirs lui est devenu insupportable. Une société, aussi, où le simple fait de demander à un immigrant de prendre le pli culturel de sa société d’accueil relèverait de l’intolérance – car la société d’accueil institutionnalisant sa culture historique plutôt que celle du nouvel arrivant ne se rendrait-elle pas coupable de discrimination?
Quelle diversité ?
Mais cette utopie globaliste oublie que l’homme n’habite le monde qu’à partir d’une culture historique particulière, qui délimite un monde commun nécessaire à l’expérience démocratique qui exige pourtant que les hommes partagent une culture et des références pour pouvoir partager un destin. En s’imaginant que toutes les cultures sont interchangeables et que les identités sont strictement individuelles, on vide alors la cité de tout substrat (cela ne veut évidemment pas dire que les cultures ne peuvent pas aussi se métisser pour le mieux, évidemment). Le mythe de l’interchangeabilité des peuples qui traite les cultures comme autant de vieux habits folkloriques consiste à nier la valeur de la culture : elles seraient de pures constructions artificielles, qui ne conditionneraient pas vraiment notre rapport au monde. Ce qu’on dit, c’est que les cultures sont «insignifiantes» et qu’elles ne structurent en fait que les préférences individuelles, selon les choix de chacun, sans fonder les sociétés. La tension entre elles ne peut donc être que le fait de personnalités intolérantes incapables de «s’ouvrir à l’autre».
La diversité dont nous parle sans cesse cette utopie globaliste, n’est pas celle des cultures et des nations, des États et des civilisations, mais seulement des individus, appelés à construire chacun leur identité à partir des matériaux culturels disponibles dans la société et le marché. L’individu s’émancipera en dépolitisant radicalement ses aspirations. Il suffirait alors d’un bon système juridique brandissant la bannière des «droits de l’homme» pour permettre à toutes les diversités de cohabiter – le politique, lui, n’est envisagé que de manière minimaliste. Partout, on installera le même système, en y pliant chaque peuple : on peut y voir une forme d’impérialisme postmoderne, où une idéologie post-nationale et post-démocratique qui se prétend universellement valable s’implante dans les sociétés pour les remodeler selon ses diktats. Évidemment, cet impérialisme idéologique qui prétend implanter un nouveau modèle de civilisation tribalise les appartenances qui ne veulent pas se traduire dans la logique de l’individualisme extrême et les présente comme tout autant de forteresses antimodernes à faire tomber.
Un fondamentalisme postmoderne ?
Ce qui se dévoile ici, c’est le fantasme de l’autoengendrement identitaire qui est si caractéristique du progressisme contemporain. D’ailleurs, n’est-ce pas le signe d’une forme de «fondamentalisme postmoderne» ? Tout est malléable, tout peut se déconstruire, il n’y a pas de nature humaine et c’est en se dépouillant de toutes ses appartenances que l’homme embrasserait l’universel. Ce n’est pas sans raison que l’idéologie du genre l’idéologie socioconstructiviste sont aussi en vogue : la première révoque l’idée de nature et la seconde, celle d’héritage, qui représentent deux obstacles intellectuels à cette société absolument malléable et radicalement indifférenciée et pouvant renaître d’une forme de néant civilisationnel. N’est-ce pas le mythe de l’homme nouveau qui renaît, de l’homme sans aspérité, de l’homme s’extirpant du passé, délivré d’une culture réduite à un bagage de préjugés, et embrassant l’humanité dans son ensemble, unie parce qu’homogénéisée? Et bien évidemment, tout ce qui s’y oppose risque d’être taxé des pires épithètes : on y verra généralement une tentation réactionnaire, animée par la peur de l’autre et évoquant les pires heures de notre temps. On oublie pourtant que l’homme sans frontières est un homme sans chez-soi.
Il importe pourtant aujourd’hui de défendre ce qui freine l’avènement d’un monde voué à l’indifférenciation globale, où la dépolitisation provoquée par un libéralisme dénaturé et fanatisé pousse les peuples à l’impuissance politique. La lutte pour l’identité nationale comme pour celle pour la souveraineté nationale se présentent ainsi comme des luttes pour préserver les cadres historiques qui contribuent à la conservation d’un humanisme véritable, conscient des nécessaires ancrages civilisationnels de toute citoyenneté. Le «fondamentalisme postmoderne» entend liquider les cultures historiques comme les États, pour permettre à un individu tout puissant, mais dépris de tous ses ancrages, d’émerger. Il nous jette dans le vide en croyant nous libérer, il nous décharne et croit nous émanciper. Le paradoxe, c’est qu’il finira même par saccager les fondements même de la société libérale dont il se prétend le meilleur surgeon. Et c’est dans ce contexte qu’il importe de rappeler que l’État-nation demeure le contrepoids indispensable pour éviter que les hommes ne se laissent décharner et broyer dans le grand malaxeur mondialisé. La défense de la société libérale ne passe par l’individualisme extrême mais par celle de la civilisation qui lui a donné naissance.
Le fondamentalisme postmoderne contre les nations
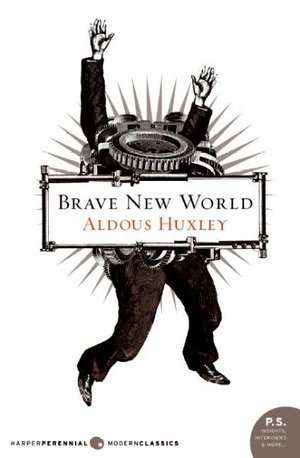
Un monde aussi glacial que terrifiant

Mathieu Bock-Côté1347 articles
candidat au doctorat en sociologie, UQAM [http://www.bock-cote.net->http://www.bock-cote.net]


















Laissez un commentaire Votre adresse courriel ne sera pas publiée.
Veuillez vous connecter afin de laisser un commentaire.
Aucun commentaire trouvé