C’est Marx qui disait que, lorsque l’Histoire bégaie, elle produit d’abord une « tragédie » et ensuite une « farce ». Est-ce parce que j’avais vécu de près le Brexit que je n’ai pas été surpris outre mesure par l’élection de Donald Trump ? À moins de six mois d’intervalle, l’élection américaine nous aura donné l’impression étrange de revivre la même séquence historique. Dans la nuit du 23 juin et celle du 8 novembre, on retrouve en effet les mêmes ingrédients de base.
Cinq mois plus tard, des quais de la Tamise aux rives de l’Hudson, ce sont la même colère et la même révolte populaires qui se sont exprimées dans les urnes. Ce sont pratiquement les mêmes couches paupérisées et déclassées qui ont fait irruption avec presque les mêmes mots, les mêmes débordements et les mêmes exubérances. Mais, le plus sidérant, c’est surtout de retrouver, à gauche et dans les médias, exactement le même aveuglement et la même cécité face à ce lent déplacement de plaques tectoniques, qui vient pourtant de provoquer une seconde éruption volcanique en moins de six mois.
Quarante-huit heures avant le vote, il régnait à Washington la même assurance tranquille qu’à Londres en juin dernier. Bien sûr, on avait eu quelques sueurs froides durant cette campagne. Mais tout allait finalement rentrer dans l’ordre. Le peuple allait revenir à la raison, rentrer au bercail. Une fois les poursuites du FBI mises de côté, presque tous les sondages prévoyaient l’élection d’Hillary Clinton. Exactement comme ceux de Londres prévoyaient la reconduction du statu quo européen. À Wall Street, on sentait la même assurance béate que dans la City. Le chantage au cataclysme économique avait porté ses fruits. Trump et le Brexit n’étaient plus que de mauvais souvenirs. Le long fleuve tranquille reprendrait enfin son cours.
Ceux qui tentent de faire de l’élection de mardi dernier une simple affaire de racisme et de misogynie se trompent royalement. Donald Trump a tout de même été élu avec le vote de 40 % des femmes et de plus du tiers des Latinos. S’il fallait en croire certains de nos analystes les moins subtils, l’Amérique serait même aujourd’hui dirigée par un « fasciste ». De grâce, revenons sur terre.
Bien sûr qu’il y a eu des déclarations misogynes et xénophobes. Bien sûr que les outrances de Donald Trump dépassent celles de Nigel Farage. Mais, au-delà d’une véritable révolte contre la rectitude politique (qui accable les États-Unis plus que n’importe quel autre pays), ces excès n’expriment que la surface des choses et non pas le fond. Quel est-il, ce fond ? C’est la vérité toute simple que, après des années de mondialisation prétendument heureuse, nous découvrons soudainement que celle-ci fut beaucoup plus sauvage qu’on ne le croyait et qu’elle a fait des perdants. Et pas qu’un peu. Des perdants que personne ne voulait voir, tant nous obnubilaient le miracle technologique, les « bienfaits de l’immigration », la société du spectacle et autres ubérisations du monde.
Aujourd’hui, le réel reprend ses droits. Or quel est-il, ce réel ? Pendant que les bourgeois bohèmes des grandes villes, avec leurs écoles privées ou internationales, leurs nounous africaines et leurs gardiens d’immeuble marocains, se félicitaient de la « diversité » du monde, des restaurants ethniques, de leur dernier voyage à Marrakech et de leur nouveau gadget électronique fabriqué à Taïwan, la vieille classe moyenne, celle des anciens quartiers industriels dévastés et des banlieues décrépites où les écoles sont peuplées à 70 % d’immigrants, a crié son ras-le-bol. Ces « ploucs » ont décidé de mettre le poing sur la table, fatigués qu’ils étaient de se faire faire la morale par une gauche hors sol qui « considère le droit à des toilettes transgenres comme la grande cause morale de notre époque », disait, en mai dernier, le politologue américain Walter Russel Mead. C’est le « consensus boomer » des 30 dernières années qui est remis en cause, écrit-il. Et, comme chaque fois que l’Histoire fait irruption sans prévenir, ce n’est pas beau, propre et poli. C’est même affreux, sale et méchant.
L’échec d’Hillary Clinton n’est pas celui d’une femme, mais d’une gauche qui a troqué le peuple contre le clientélisme multiculturel. Un peuple qu’elle regarde de haut et qu’elle range dans « le panier des pitoyables », pour reprendre les mots exacts de la candidate. Or on ne troque pas l’AFL-CIO contre les LGBT sans conséquences. L’addition des immigrants, des homosexuels, des musulmans, des noirs, des femmes et des queers ne fait pas un peuple. Cela fabrique plutôt des ghettos !
> Lire la suite de l'article sur Le Devoir
Le Brexit bis
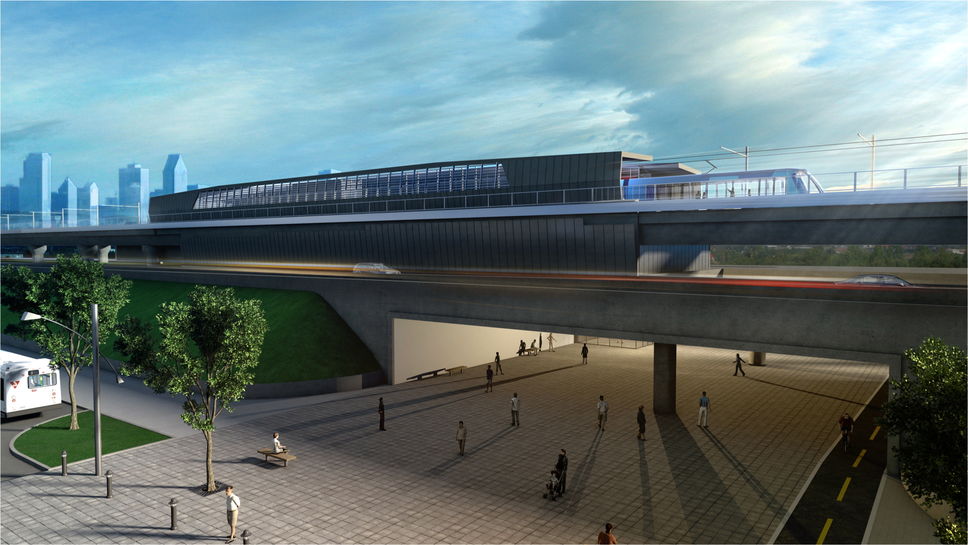
























Laissez un commentaire Votre adresse courriel ne sera pas publiée.
Veuillez vous connecter afin de laisser un commentaire.
Aucun commentaire trouvé