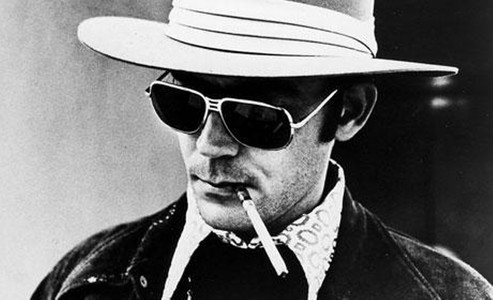Le « party » est terminé !
8 janvier 2016
Le pétrole bitumineux se vends avec un gros escompte :
Canadian heavy crude oil collapse below $20 - a record low!!
Current prices are “below shut-in levels,” said Tim Pickering, founder and chief investment officer of Auspice Capital Advisors Ltd. in Calgary. There’s no incentive to ship Canadian crude to the U.S. Gulf Coast and producers may start annual maintenance sooner than planned, he said. “We’re the last barrel produced and we’re the first barrel shut in.”
http://www.zerohedge.com/news/2016-01-08/if-you-are-oil-bull-dont-look-these-2-charts
JCPomerleau